Dénué de radars météorologiques et de satellites, Haïti doit compter sur la bonne volonté d’autres pays ou d’institutions internationales pour ses prévisions
En pleine saison cyclonique, Haïti a failli perdre l’accès à une importante source de données météorologiques.
L’administration américaine avait suspendu, le 25 juin 2025, le partage de certaines données satellitaires fournies par le département de la Défense (DMSP) via l’Administration nationale océanique et de l’atmosphère (NOAA).
Ces données sont destinées à la surveillance des cyclones dans l’Atlantique Nord.
L’arrêt du partage de données satellitaires militaires américaines essentielles à la surveillance des ouragans a finalement été suspendu.
Les autorités americaines ont décidé de maintenir l’accès à ces données jusqu’à la fin officielle du programme, en septembre 2026, après des appels à la prudence lancés par des météorologues.
La suspension, concernait l’ensemble des Antilles, et aurait affecté la qualité des prévisions météorologiques en Haïti.
L’épisode met en lumière un problème crucial : Haïti ne dispose pas de moyens techniques et financiers pour générer ses propres données, selon deux sources institutionnelles directement impliquées dans la surveillance météorologique et la gestion des risques ainsi qu’un météorologue, contactés par AyiboPost.
Selon un courriel publié par la NOAA, les États-Unis avait décidé d’interrompre ce programme afin « d’atténuer un risque important de cybersécurité ».
Entamé dans les années 1970, ce programme de partage de données satellitaires météorologiques vise à renforcer la coopération internationale en matière de surveillance du climat et de prévision des catastrophes naturelles, notamment les cyclones tropicaux.
Si les Etats-Unies n’étaient pas revenus sur la décision, Haïti aurait continué de bénéficier d’autres données météorologiques et climatiques fournies par des instances régionales ou via d’autres pays, rassure Esterlin Marcelin, coordinateur général de l’Unité hydrométéorologique d’Haïti (UHM).
Mais les prévisions auraient perdu en précision, alertent les experts.
Emmanuel Pierre, directeur de la Direction générale de la protection civile (DGPC) souligne l’importance de ces données issues des satellites en orbite basse pour les prises de décisions, principalement pour l’analyse précise des tempêtes ou des phénomènes météorologiques qui avancent lentement et qui sont susceptibles d’entraîner de graves dégâts, comme de fortes pluies ou des inondations.
Faute de radars météorologiques fonctionnels sur son territoire, Haïti utilise parfois ceux installés dans des pays voisins, notamment en République dominicaine et à Cuba pour suivre l’évolution des conditions météorologiques.
Dans le temps, le Centre national de météorologie (CNM) disposait de radar pouvant aider dans les détections ainsi que la météo globale pour les aéroports, le directeur de la DGPC, Emmanuel Pierre, indique que « ces systèmes sont défectueux et ne sont pas réparés ».
Les satellites du programme DMSP, gérés par le département de la défense américain, sont d’utilité militaire.
Cependant, la NOAA, ayant accès aux données issues de ces satellites, les traite et les intègre dans des modèles climatiques ou dans ses bases de données pouvant être consultées par des pays, des plateformes régionales affiliées ou encore via l’Organisation météorologique mondiale (OMM).
Les satellites à orbites polaires dont se sert le DMSP évoluent à quelque 800 kilomètres autour de la terre et survolent les pôles Nord et Sud toutes les 100 minutes environ.
Équipés de sondeurs embarqués, ces satellites mesurent avec précision la température de l’atmosphère et des océans, avant de transmettre ces données aux stations au sol où elles sont ensuite analysées par des centres spécialisés.
Pour le météorologue Rudolphe Homère Victor, ces données permettent « de compenser les limites de l’imagerie conventionnelle qui n’offre pas une vue détaillée de l’intérieur des cyclones ».
En raison de son emplacement dans le bassin caribéen, Haïti est régulièrement confronté à des phénomènes météorologiques causant d’importants dégâts humains et matériels.
Lire plus : Peut-on faire confiance aux bulletins météo en Haïti ?
En 2016, l’ouragan Matthew avait occasionné plusieurs centaines de morts ainsi que des dégâts matériels considérables dans le Sud du pays.
D’autres catastrophes naturelles ont également marqué les dernières décennies en Haïti, comme l’ouragan Sandy en 2012, Ike en 2008 ou Georges en 1998.
Les données météorologiques et climatiques se retrouvent parfois au cœur d’une dynamique géopolitique à l’échelle mondiale.
Par exemple, des pays comme la Chine considèrent certaines données météorologiques comme des ressources stratégiques relevant de la sécurité nationale, limitant ainsi leur diffusion à l’international.
Cette diversité d’approche crée parfois des disparités dans l’accès de certains pays à faibles revenus, notamment à l’heure des changements climatiques, dont les conséquences ne s’arrêtent pas aux frontières des pays.
En vue de faire face aux inégalités d’accès et à la privation croissante des données météorologiques et climatiques au niveau mondial, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) a adopté en octobre 2021, une politique unifiée, juridiquement contraignante, favorisant un échange libre et sans restrictions des données d’observations, de prévisions, et d’avertissement.
La saison cyclonique de 2025 s’annonce particulièrement intense dans la région caraïbe.
« Les prévisions de cette année sont au-dessus de la moyenne », indique Emmanuel Pierre à AyiboPost.
Treize tempêtes sont attendues, dont neuf ouragans, parmi lesquelles quatre pourraient atteindre une intensité majeure, dépassant la catégorie 3.
Ces prévisions suscitent des inquiétudes, alors que plus d’un million de personnes sont déjà déplacées à l’intérieur du pays en raison des violences des gangs.
Treize tempêtes sont attendues, dont neuf ouragans, parmi lesquelles quatre pourraient atteindre une intensité majeure, dépassant la catégorie 3.
La DGPC affirme accorder une attention particulière aux personnes déplacées internes (PDI) dans les départements de l’Ouest, du Centre et de l’Artibonite, dans le but de renforcer sa capacité à leur venir en aide.
Des travaux de réduction des risques liés aux catastrophes sont prévus dans au moins vingt grands centres urbains, accompagnés d’un renforcement des capacités des structures communales de la Protection civile, selon Emmanuel Pierre.
Par : Jérôme Wendy Norestyl
Cet article a été mis à jour pour prendre en compte l’annulation de la décision de ne plus partager les données métérologiques. 20.56 4.8.2025
Représentation artistique d’un satellite GOES de la NOAA (à gauche) et d’un satellite JPSS de la NOAA (à droite) en orbite autour de la Terre. Source : NOAA
► AyiboPost s’engage à diffuser des informations précises. Si vous repérez une faute ou une erreur quelconque, merci de nous en informer à l’adresse suivante : hey@ayibopost.com
Gardez contact avec AyiboPost via :
► Notre canal Telegram : cliquez ici
►Notre Channel WhatsApp : cliquez ici
►Notre Communauté WhatsApp : cliquez ici






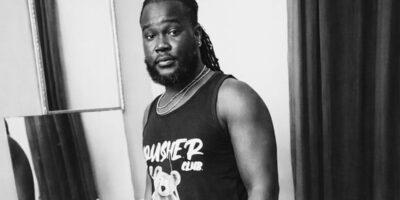
Comments