“And power, money, and access to resources — good housing, better education, fair wages, safe workplaces, clean air, drinkable water, and healthier food — translate into good health. “Bassets and Galeo, 2021
Des recherches récentes établissent un lien entre la violence coloniale et les inégalités de santé parmi les populations anciennement colonisées.
Dans le cas haïtien, ces travaux soulignent que la guérison des traumatismes historiques exige un cadre de santé publique réparatrice, centré sur les expériences vécues des communautés locales. S’appuyant sur ce cadre, plusieurs études démontrent que des politiques réparatrices peuvent améliorer significativement les résultats sanitaires, réduire la transmission virale et atténuer les inégalités raciales. Elles insistent également sur le fait que les réparations doivent aller au-delà de simples compensations financières pour inclure des investissements structurels durables dans les systèmes de santé.
Comme mes collègues et moi l’avons déjà souligné, cette approche, appliquée à Haïti, appelle à repenser la santé publique selon une logique communautaire, équitable et décoloniale. Elle prend tout son sens à la lumière de l’histoire médicale du pays, marquée par l’héritage de l’esclavage, le poids de la dette coloniale imposée par la France, et l’occupation américaine.
De 1804 à 1950, Haïti est ainsi passé d’une quasi-absence d’infrastructures médicales à une phase d’expérimentation étatique, souvent conditionnée par des influences étrangères. L’histoire de la médecine en Haïti, entre 1804 et 1950 dénote une continuité de violence — de la domination esclavagiste à la domination biomédicale, soulignant une forme de contrôle systémique sur les corps haïtiens.
De même que cette histoire reflète une transformation lente, inégale, profondément conditionnée par les dynamiques sociopolitiques internes et l’influence des puissances étrangères.
De 1804 à 1950, Haïti est ainsi passé d’une quasi-absence d’infrastructures médicales à une phase d’expérimentation étatique, souvent conditionnée par des influences étrangères.
De la fondation de l’État haïtien sous Jean-Jacques Dessalines, à l’imposition de la double dette de l’indépendance par l’ancienne puissance coloniale française entre 1825 et 1947, à l’après-occupation américaine, le pays est passé d’une quasi-absence d’infrastructures médicales à une phase d’expérimentation à grande échelle, notamment durant l’occupation des États-Unis (1915–1934).
Cette période, tout en initiant une modernisation sanitaire partielle, a aussi servi de cadre à l’imposition de modèles impérialistes de santé publique. Haïti devint ainsi un laboratoire privilégié de la médecine tropicale et des politiques biopolitiques nord-américaines.
Premiers États post indépendance : symbolisme et délaissement sanitaire (1804–1843)
Au lendemain de l’indépendance, la jeune nation haïtienne, dirigée d’abord par Dessalines (1804–1806), puis divisée entre Henri Christophe (Nord) et Alexandre Pétion (Sud), ne développe que très peu de structures médicales. Les soins sont majoritairement prodigués par des guérisseurs populaires ou, plus rarement, par des médecins étrangers.
Sous Henri Christophe, une tentative de construction étatique se manifeste : des écoles, hôpitaux et même une école rudimentaire de médecine sont créés. Il fait appel à des enseignants étrangers, notamment des États-Unis et de Grande-Bretagne, dans le but de rehausser le niveau d’alphabétisation et de promouvoir une élite administrative et sanitaire.
Pétion, en revanche, favorise la redistribution des terres au détriment du développement institutionnel. Les initiatives de santé publique y sont presque absentes, et la gouvernance décentralisée semble avoir empêché une réponse coordonnée aux épidémies. Les maladies infectieuses – telles que la variole, la malaria ou le paludisme et la typhoïde – sévissent sans réelle réponse étatique. En 1817-1818, une grave épidémie de paludisme frappe Port-au-Prince, causant notamment la mort de Pétion. Ces maladies, déjà présentes au XVIIIe siècle (épidémies en 1739, 1742, 1744, 1766), persistent sans interruption après l’indépendance.
Sous Jean-Pierre Boyer (1820–1843), quelques efforts d’organisation émergent. Des tentatives embryonnaires d’enseignement médical apparaissent, bien que réservées à une élite urbaine.
Le Dr Porter Lowell incarne ces débuts institutionnels, mais l’accès aux soins modernes demeure marginal. En dépit d’une centralisation autoritaire du pouvoir, le gouvernement Boyer reste incapable de résoudre les difficultés économiques, aggravées par le remboursement de l’« indemnité » imposée par la France en 1825.
Instabilité politique et tentatives de structuration (1843–1888)
La révolution de 1843, menée par Charles Rivière-Hérard, met fin au régime de Boyer, accusé d’autoritarisme et d’échec économique. S’ensuit une période de grande instabilité (1843–1867), durant laquelle les rares hôpitaux existants se dégradent ou sont transformés en abris. Les épidémies de fièvre jaune, dysenterie et variole prospèrent dans un contexte d’hygiène urbaine catastrophique. Sous Sylvain Salnave et Nissage Saget (1867–1879), certaines structures hospitalières sont partiellement réhabilitées et des campagnes de vaccination contre la variole sont initiées. Des figures comme le Dr François Dalencour marquent les premières contributions concrètes à l’organisation sanitaire du pays. Sous Lysius Salomon (1879–1888), Haïti s’insère timidement dans les réseaux internationaux de santé publique. En 1881, elle participe à la Conférence sanitaire internationale de Washington, visant à harmoniser les politiques de quarantaine. Bien que les informations sur les politiques internes de Salomon soient limitées, cette participation révèle une prise de conscience gouvernementale croissante vis-à-vis des enjeux sanitaires globaux.
Naissance d’une médecine haïtienne et débuts des réformes scientifiques (1889–1915)
Sous Florvil Hyppolite et Tirésias Simon Sam (1889–1902), des cliniques médicales à vocation scientifique voient le jour dans les centres urbains. Le Dr Léon Audain émerge alors comme une figure pionnière. Fondateur du Laboratoire de Clinique Médicale, il promeut une médecine fondée sur l’observation, la recherche en laboratoire et l’hygiène. Il initie également une école de pensée médicale à laquelle participent de jeunes médecins comme Charles Mathon.
Cependant, les présidences suivantes (Nord Alexis, Antoine Simon, Cincinnatus Leconte, Tancrède Auguste) sont marquées par la stagnation. L’État investit peu dans la santé, tandis que la tuberculose, la syphilis et la mortalité infantile deviennent endémiques.
L’occupation américaine : un tournant biopolitique (1915–1934)
L’occupation militaire américaine, initiée après l’assassinat du président Vilbrun Guillaume Sam, transforme profondément la santé publique haïtienne. Sous l’impulsion des Marines et de la Fondation Rockefeller (notamment sa International Health Division), un système de santé centralisé est imposé.
Des campagnes de masse sont menées contre le pian, la lèpre, le paludisme, les vers intestinaux et la typhoïde. Plus de 100 000 personnes reçoivent du Salvarsan dans le cadre de la lutte contre le pian. Des modèles inspirés des campagnes sanitaires à Cuba et au canal de Panama sont appliqués pour le contrôle du paludisme. La vaccination obligatoire contre la variole atteint plus d’un million d’Haïtiens. Ces interventions, bien qu’efficaces sur certains plans, s’inscrivent dans une logique impérialiste. Elles transforment Haïti en espace d’expérimentation biomédicale, marginalisant les savoirs locaux et les pratiques endogènes.
Période post-occupation et continuité inachevée (1934–1950)
Après le départ des troupes américaines, les présidents Sténio Vincent (1934–1941) et Élie Lescot (1941–1946) poursuivent certaines politiques sanitaires. Vincent mise sur l’amélioration des infrastructures, ce qui bénéficie indirectement à la santé publique. Toutefois, la pauvreté reste extrême, les maladies infectieuses sévissent dans les campagnes, et l’accès aux soins demeure limité.
Lescot, bien que coopérant avec les États-Unis dans certains projets sanitaires conformément à la conférence de Rio (1942), est accusé de corruption et d’autoritarisme. Des programmes comme la SHADA (Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole), visant à intensifier la production de caoutchouc en période de guerre, provoquent le déplacement de populations rurales, sans retombées économiques notables. Les gains sanitaires sont donc éclipsés par l’échec des politiques agricoles et le détournement des ressources.
L’occupation militaire américaine, initiée après l’assassinat du président Vilbrun Guillaume Sam, transforme profondément la santé publique haïtienne.
Sous Dumarsais Estimé (1946–1950), une tentative de nationalisation des politiques sanitaires se dessine.
Le gouvernement vise une couverture accrue dans les zones rurales, en mettant l’accent sur les maladies négligées (lèpre, parasitoses), malgré des ressources financières limitées. Sous la présidence de Dumarsais Estimé, la santé publique en Haïti continua de faire face à d’importants défis. Bien que le pays ait une tradition de soins médicaux dirigés par l’État, l’accès à des services de santé de qualité — en particulier dans les zones rurales — demeurait très limité.
La population souffrait de nombreux problèmes sanitaires, notamment des taux élevés de mortalité infantile et juvénile, de malnutrition, ainsi que de maladies endémiques telles que la tuberculose, le paludisme et d’autres maladies évitables par la vaccination.
Le gouvernement d’Estimé entreprit certains efforts pour améliorer la santé publique, notamment en invitant en 1948 une mission technique des Nations Unies afin d’évaluer les besoins en matière d’eau et d’assainissement. Selon le Office of the Historian du Département d’État des États-Unis, le gouvernement haïtien coopéra également avec l’Inter-American Affairs Agency (IIAA) dans le cadre d’initiatives visant à améliorer les conditions sanitaires et la production alimentaire de base.
Cependant, cette période fut marquée par des difficultés persistantes liées à la pauvreté, au manque d’infrastructures et aux divisions sociales, qui eurent un impact négatif sur les indicateurs de santé. Le système de santé souffrait d’une fragmentation institutionnelle et d’un manque de coordination, aggravés par le fonctionnement indépendant de nombreuses organisations non gouvernementales. La médecine traditionnelle et les pratiques culturelles comme le vaudou restaient fortement présentes aux côtés de la médecine occidentale, traduisant les attitudes culturelles complexes des Haïtiens à l’égard de la santé et de la guérison.
La période entre l’indépendance d’Haïti en 1804 et le milieu du XXe siècle a été profondément marquée par le lourd fardeau de la « double dette » – une indemnité exigée par la France ainsi que les emprunts contractés pour la payer – qui a eu un impact considérable sur les conditions de santé publique dans le pays. La dette colossale a gravement limité la capacité d’Haïti à investir dans les infrastructures essentielles, telles que les hôpitaux, les écoles et les services publics. Le système de santé publique est demeuré fragile et sous-financé, avec un accès restreint aux soins de santé de base pour la majorité de la population, en particulier dans les zones rurales. Les barrières géographiques, le manque d’établissements de soins et certaines coutumes ont également entravé l’accès aux services de santé. Les maladies infectieuses telles que le paludisme et la fièvre jaune étaient répandues, aggravées par des conditions sanitaires précaires et des interventions médicales limitées. La malnutrition et l’insécurité alimentaire, exacerbées par les conséquences socio-économiques de la rançon de l’indépendance et le déclin de l’agriculture, ont accru la vulnérabilité de la population face aux maladies.
Durant l’occupation américaine, certains progrès ont été observés dans les services de santé publique, notamment la création du Service de santé publique haïtien, axé sur l’éradication des moustiques et la lutte contre le paludisme. La présence américaine a également conduit à l’établissement de cliniques et d’hôpitaux en zones rurales, bien que ces initiatives aient été critiquées pour avoir servi les intérêts des États-Unis plus que ceux de la population haïtienne.
La médecine durant cette période visait à protéger les forces d’occupation américaines contre les maladies tropicales et servait aussi d’outil de propagande pour justifier l’occupation. L’occupation américaine constitue le moment pivot, modernisant les dispositifs médicaux tout en inscrivant la santé publique dans une logique de domination biopolitique. La médecine devient un outil de contrôle social, de hiérarchisation raciale et de restructuration sociale au service d’intérêts géostratégiques. L’héritage de cette époque se fait encore sentir aujourd’hui : dans les inégalités d’accès aux soins, dans la méfiance envers les interventions internationales, et dans les tensions non résolues entre souveraineté nationale et santé globale.
Par :Dr. Judite Blanc Ph.D
Prof. Chercheuse Adjointe de Psychiatrie
Ecole de Médicine de l’Université de Miami
Couverture | Une foule vibrante défile dans la rue, brandissant fièrement le drapeau d’Haïti. Source : Haïtionderland
► AyiboPost s’engage à diffuser des informations précises. Si vous repérez une faute ou une erreur quelconque, merci de nous en informer à l’adresse suivante : hey@ayibopost.com
Gardez contact avec AyiboPost via :
► Notre canal Telegram : cliquez ici
►Notre Channel WhatsApp : cliquez ici
►Notre Communauté WhatsApp : cliquez ici

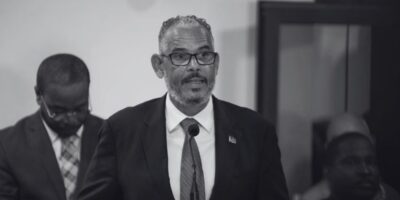



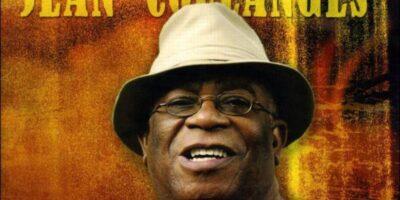

Comments