L’insurrection du 22 août n’est pas un simple fait divers dans l’histoire. C’est un cri de liberté, un rejet radical d’un ordre mondial injuste, et le point de départ d’un processus irréversible vers 1804
Revisiter suppose qu’on ait déjà visité, qu’on se soit déjà fait une première idée. C’est revenir, cette fois avec un autre regard, peut-être pour nuancer ou corriger ce qu’on pensait savoir. Il m’a semblé essentiel de poser cela d’entrée de jeu, avant d’aborder le cœur du sujet : revisiter l’insurrection du 22 août 1791 dans une perspective décoloniale. Que ce soit dans nos manuels scolaires, dans les débats publics, ou à travers le silence parfois volontaire d’une partie de la communauté scientifique, les récits autour de cette insurrection sont souvent tronqués, déformés, voire détournés de leur portée historique et ontologique.
Juste en guise de constat : ce n’est que très récemment qu’un décret a élevé le 14 août au rang de congé national, au même titre que la fête de Notre-Dame le 15. Mais l’insurrection qui débuta dans la nuit du 22 au 23 août 1791, subit encore un déficit de communication. Si Vertières le 18 Novembre et l’Indépendance le 1er janvier trouvent peu à peu leur place dans l’espace public, devenant même des événements de tendance sur les réseaux sociaux, l’insurrection, elle, reste encore dans l’ombre, absente des calendriers, ignorée comme date de mémoire collective.
Dans l’échelle des valeurs historiques, on accorde peu d’importance à la révolte générale des esclaves comme le génocide des indigènes d’ailleurs. Mais pourquoi donc cet ‘‘oubli volontaire’’ ? Pourquoi ce mépris ou ce silence autour de l’insurrection du 22 au 23 août ? Est-ce parce qu’elle représente l’acte fondateur qui sonna le glas contre un système d’oppression séculaire ? Des interrogations essentielles, sur lesquelles nous reviendrons au fil de cette réflexion.
Commençons par rappeler ce qu’est cette insurrection : un soulèvement massif d’esclaves, conséquence directe de la cérémonie du Bois Caïman tenue quelques jours plus tôt dans la même région.
Cette cérémonie, souvent réduite à son aspect mystique, fut surtout le point culminant d’une prise de conscience collective. Elle marque l’aboutissement de siècles d’asservissement, imposés aux Indigènes et aux Africains pour alimenter le colbertisme français. Tandis que l’Angleterre se vantait de sa révolution industrielle, la France bâtissait sa prospérité sur le dos des esclaves de Saint-Domingue, sa perle coloniale, la grande et fière République d’Haïti aujourd’hui.
L’insurrection du 22 août n’est pas un simple fait divers dans l’histoire. C’est un cri de liberté, un rejet radical d’un ordre mondial injuste, et le point de départ d’un processus irréversible vers 1804.
Mais il faut dire que Bois Caïman n’aurait jamais eu lieu sans les premières formes de résistance, la constitution des premiers marrons indigènes dans les montagnes de Bahoruco, ensuite l’arrachement brutal à la terre mère, l’Afrique. Bien avant la cérémonie, certains, notamment parmi les Ibos, ont préféré le suicide, parfois collectif, plutôt que de se laisser traîner vers une terre promise dans l’enfer des plantations. D’autres ont résisté autrement : en empoisonnant leurs maîtres, en refusant de donner naissance à des enfants esclaves par l’avortement volontaire, ou encore en fuyant vers les montagnes, dans le marronnage. Toutes ces formes de résistance sont autant de balises sur le long chemin de l’éveil à une conscience lucide d’une réalité inhumaine.
Jean Price-Mars soulignait à juste titre que l’arrivée des premiers contingents nègres sur l’Ile d’Haïti devenue Hispaniola avec la colonisation espagnole fut source d’inquiétude pour les Espagnols, car ces derniers poursuivirent le marronnage. Si ces premières formes de résistance prenaient souvent la forme d’actions isolées individuelles ou en petits groupes, le dyptique de 1791, constitué de la cérémonie du Bois Caïman, véritable prise de conscience collective, et de l’insurrection du 22 août, marque le basculement vers des mouvements d’ensemble. Ce sont ces événements conjoints qui ont enclenché le processus irréversible menant à l’indépendance.
Ceci étant dit, intéressons-nous à quelques éléments récurrents dans les narratifs historiques qui trahissent des relents persistants de colonialité. On présente trop souvent la cérémonie du Bois Caïman et l’insurrection du 22 août comme des événements spontanés, fruits du hasard, sans préparation ni vision stratégique. Cela participe à entretenir le préjugé colonial du Noir “bête de somme”, incapable de réfléchir ou de s’organiser. Jean Casimir l’illustre avec justesse lorsqu’il affirme : “La société coloniale ne reconnaissait pas aux Noirs le droit de penser et d’agir à leur gré, les réduisant à des biens meubles.”
Ce regard biaisé sur l’histoire empêche encore aujourd’hui une juste reconnaissance de l’intelligence collective et du génie politique de ceux qui ont posé les bases de notre liberté.
La dévalorisation du Bois Caïman comme acte fondateur est une stratégie bien pensée. Certains courants chrétiens, notamment dans le Protestantisme, proposent de « remplacer » le sang du cochon par celui de Jésus, comme pour effacer la portée symbolique et politique de cette cérémonie. Aux États-Unis, un mouvement dans la diaspora appelé Bossales choisit Jésus comme unique leader, rejetant toute référence au Bois Caïman. Je pourrais parler pendant des heures du rejet souvent violent de cette cérémonie, mais ce n’est pas le cœur du sujet ici.
Ce mouvement fondateur est donc présenté dans les narratifs dominants comme une scène d’anarchie, et non pour ce qu’il est vraiment : un acte structuré de révolte et de conscience collective.
Depuis l’époque coloniale, on nous a conditionnés à percevoir Biassou, Toussaint, Makandal comme de simples manipulateurs, jamais comme des stratèges ou des leaders visionnaires.
Le rejet des cultures africaines ou de toute culture qui ne s’aligne pas sur le modèle occidental empêche toute lecture juste de notre histoire. En niant la vision du monde des premiers habitants de l’Île ou des Africains, en refusant de reconnaître la richesse de leurs stratégies de guerre, de leur éthique propre, on se coupe de la possibilité de se reconnecter à nos ancêtres. Et sans cette connexion, il devient difficile de nous lever contre les formes d’oppression qui, sous d’autres visages, persistent encore aujourd’hui.
Le fait pour nous de ne pas transcender la chronologie que l’Occident nous impose joue en notre défaveur. L’Occident situe le début de son épopée après Jésus-Christ, il y a environ 2000 ans. Pourtant, en Afrique, des récits, des traces archéologiques et anthropologiques, comme celles autour de Lucy datant de 3,2 millions d’années témoignent d’une humanité noire ancienne et riche. Ce sont des repères qui pourraient nous conforter dans notre pleine humanité, dans notre statut d’hommes et de femmes noirs porteurs d’histoire, de savoirs et de civilisation bien avant toute domination occidentale.
Quels sont donc les mécanismes mis en place pour perpétuer ces éléments de colonialité ?
L’un des plus puissants reste le système éducatif hérité de l’époque coloniale, façonné au rabais par les missionnaires catholiques, surtout après la signature du Concordat. Ce modèle n’était pas conçu pour émanciper, mais pour encadrer et maintenir une main-d’œuvre obéissante et docile.
Prenons l’enseignement du français : alors que la France et le Québec évoluent vers des approches contemporaines, interactives, ancrées dans le réel, nous sommes encore figés dans le classicisme, à apprendre des textes et des références déconnectées de notre vécu. Et ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres.
À cela s’ajoutent : L’absence d’une politique linguistique valorisant le créole comme langue de savoir et non seulement de communication informelle ; la marginalisation des savoirs traditionnels (oralité, médecine populaire, cosmologie africaine, etc.) au profit d’un savoir dit « académique » à la sauce occidentale ; le contrôle des programmes scolaire et des manuels d’histoire, où l’on évite soigneusement d’aborder certains sujets de manière décoloniale ; la faiblesse de la recherche locale, par manque de financement mais aussi par manque de valorisation des penseurs haïtiens.
Pour ce qui est de l’histoire, on nous fait souvent considérer Marie Sainte Dédé Bazile comme une folle, au lieu d’admirer la bravoure dont elle a fait preuve en enterrant l’empereur. Le Bois Caïman est réduit à une simple cérémonie mystique, comme pour l’éloigner des concitoyens chrétiens. Quant à l’insurrection, elle est présentée comme un acte de barbarie à négliger, voire à passer sous silence par pudeur.
Price Mars proposait la réappropriation de notre histoire et de notre culture comme un levier essentiel pour décoloniser les esprits.
Le Vodou, souvent diabolisé, est pourtant un creuset de résistance, mais aussi une source précieuse d’informations sur notre passé.
Le rejet des cultures africaines ou de toute culture qui ne s’aligne pas sur le modèle occidental empêche toute lecture juste de notre histoire. En niant la vision du monde des premiers habitants de l’Île ou des Africains, en refusant de reconnaître la richesse de leurs stratégies de guerre, de leur éthique propre, on se coupe de la possibilité de se reconnecter à nos ancêtres. Et sans cette connexion, il devient difficile de nous lever contre les formes d’oppression qui, sous d’autres visages, persistent encore aujourd’hui.
Enfin, et ce n’est pas le moindre, il y a l’acculturation à travers tous les types de médias. Sur les écrans, dans les journaux, Haïti n’est évoquée que lorsqu’un malheur survient. Si 1804 n’est toujours pas appréhendé du grand public, même s’il fait l’objet d’une célébration festive sur le web haïtien, c’est encore pire pour l’insurrection, qui elle, ne bénéficie pas de cette reconnaissance.
Contrer les effets pervers de la colonialité du savoir
La culture populaire haïtienne a été l’objet d’une diabolisation systématique remontant à l’époque coloniale et prolongée bien après l’indépendance. Cette campagne idéologique visait à disqualifier les pratiques culturelles, religieuses et symboliques issues des traditions indigènes et africaines, notamment le Vodou, dans le but de légitimer et pérenniser l’ordre colonial.
1. Justifications idéologiques de l’ostracisme
Le commerce transatlantique des esclaves, suite au génocide des indigènes, moteur économique de l’expansion européenne du XVIe au XIXe siècle, nécessitait une légitimation morale. Pour justifier l’asservissement de millions d’Africains, un récit théologique fut élaboré : la « malédiction de Cham », interprétation biaisée d’un passage biblique, servit à naturaliser l’infériorité supposée des peuples noirs. Dans cette perspective, l’africain, forcé de devenir esclave fut réduit à une figure déshumanisée : un « nègre de plantation », assimilé à une force de travail biologique, voire à un combustible vivant pour l’économie coloniale.
Ce paradigme dualiste opposait la valorisation absolue des attributs européens : la peau blanche, les langues, les religions chrétiennes, les institutions politiques, la culture, les modes de vie, face à la dévalorisation systématique de tout ce qui se rattachait à l’Afrique : couleur noire, traits négroïdes, spiritualités traditionnelles, musiques, danses, pratiques médicinales, langues vernaculaires et surtout le Vodou.
2. Continuités post-indépendances et stratégies de domination
L’aliénation culturelle instaurée par le Code noir, qui interdisait les langues africaines, les danses, les rites, a trouvé des prolongements dans les politiques haïtiennes post-indépendances. La fameuse « campagne antisuperstitieuse » de 1941, appuyée par l’Église catholique, l’armée et certains secteurs de l’État, intensifia cette stigmatisation à travers la destruction physique des Ounfò, des Péristyles, des objets sacrés, des arbres rituels, prolongeant l’héritage de l’Inquisition coloniale.
Ce processus a produit une intériorisation durable de l’infériorité culturelle, engendrant une forme d’auto-dévalorisation, voire d’autodestruction psychique, profondément ancrée dans l’inconscient collectif haïtien. Il en résulte une obsession persistante de reconnaissance par l’ancienne métropole, conduisant à la reproduction des valeurs de la société coloniale en l’absence des colons.
3. Mécanismes contemporains de la manipulation culturelle
Cette entreprise de diabolisation s’est raffinée par le biais des agents de la socialisation : écoles, églises, médias, ONG, littérature, cinéma, discours scientifiques et religieux. L’influence idéologique s’est diffusée jusque dans les milieux dits progressistes, où les modèles de pensée restent souvent tributaires de paradigmes eurocentrés, sans effort d’adaptation aux réalités culturelles locales.
Nombre d’éducateurs, animateurs, missionnaires, journalistes, deviennent consciemment ou non, les relais d’une désinformation construite sur plusieurs siècles. Cette domination idéologique a pour effet de priver les Haïtiens d’une politique culturelle cohérente, inclusive et décolonisée, fondée sur leurs propres référents symboliques et spirituels.
4. L’illusion de la modernité : éducation, religion, aliénation
L’éducation en Haïti a longtemps été un outil d’oppression culturelle. Comme le soulignait Jean Price-Mars, elle visait à convaincre la jeunesse haïtienne de son infériorité, à la dépersonnaliser, à lui faire honte de son héritage culturel. Loin de promouvoir un esprit critique universel, elle favorisait l’assimilation, la servilité et le rejet de soi.
La religion dominante, pour sa part, a souvent été l’auxiliaire de l’État dans ce processus d’aliénation. En niant toute validité aux spiritualités indigènes et africaines, elle a contribué à la marginalisation du Vodou et à sa réduction à une caricature démoniaque. Le résultat en est une société fragilisée, coupée de ses racines, incapable de valoriser ses ressources culturelles, intellectuelles et spirituelles.
5. Une voie de salut : réappropriation culturelle et souveraineté spirituelle
Il est vain d’espérer une quelconque autonomie économique sans autonomie spirituelle. La pauvreté matérielle est intimement liée à la dépossession symbolique. Une société incapable de transformer ses ressources culturelles en énergie de création est condamnée à la stagnation.
La culture populaire haïtienne a été l’objet d’une diabolisation systématique remontant à l’époque coloniale et prolongée bien après l’indépendance. Cette campagne idéologique visait à disqualifier les pratiques culturelles, religieuses et symboliques issues des traditions indigènes et africaines, notamment le Vodou, dans le but de légitimer et pérenniser l’ordre colonial.
Seule une politique de réappropriation culturelle consciente, critique et inclusive peut redonner à Haïti les moyens de son émancipation. Il ne s’agit pas de retour au passé, mais de reconquête de soi, de réconciliation avec son héritage, et de mise en valeur de ses propres formes de savoirs, de spiritualité et de résistance.
Il faut redéfinir une autre relation entre Nous, entre les peuples en considérant que le soulèvement des esclaves précède le crédo de Dessalines Tout moun se Moun.
Revenons à Jean Price Mars, lui qui encourageait à valoriser les apports africains de notre culture. Appliquons ce qu’il a théorisé dans ‘’La Vocation de l’élite’’. Écoutons la voix de Jean Casimir qui disait du créole que c’est un outil de communication essentiel pour contrer la domination linguistique.
Réhabilitons le Vodou, loin des caricatures occidentales, retrouvons les pensées indigénistes et les érudits des années 1920.
Et enfin, célébrons la huitaine de la liberté : faire du 14 au 22 août une vraie semaine de mémoire, où l’on souligne à quel point ces deux événements sont intimement liés.
Revisiter l’insurrection de 1791, ce n’est donc pas seulement faire mémoire. C’est réancrer cette histoire dans le présent pour mieux affronter les récits dominants, et poser les jalons d’un avenir libéré des chaînes symboliques de la colonisation.
Par : Louise Carmel Bijoux
Formatrice
Médiatrice Culturelle
Port-au-Prince, Haïti
Septembre 2025
► AyiboPost s’engage à diffuser des informations précises. Si vous repérez une faute ou une erreur quelconque, merci de nous en informer à l’adresse suivante : hey@ayibopost.com
Gardez contact avec AyiboPost via :
► Notre canal Telegram : cliquez ici
► Notre Channel WhatsApp : cliquez ici
► Notre Communauté WhatsApp : cliquez ici




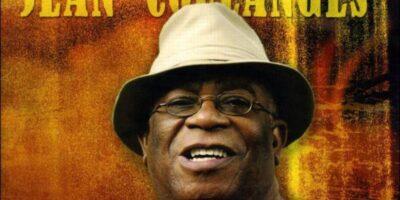

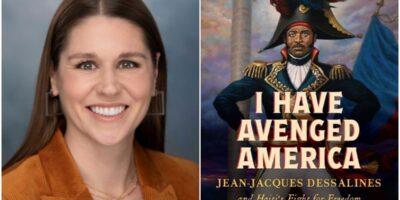
Comments