Qu’est-ce que l’aristocratie ? Et en quoi la démocratie, l’institution du peuple comme instance de souveraineté ou de puissance politique ne se débarasse pas par trop grande différence de l’aristocratie ? La démocratie camoufle son aristocratisme, sa passion du pouvoir détenu par les fils des dieux, pourvus des facultés nobilaires de puissance, d’intelligence ou de ruse, de secret ou de mise en scène. Comment dire cet aristocratisme de la démocratie ?
On s’inquiète de l’avenir de la démocratie comme si celle-ci serait l’essence de la politique. En effet, cette inquiétude ou déception est en parallèle aux liesses des « transitions démocratiques », qui ont été très peu soutenues par des accompagnements théoriques (du moins dans le cas haïtien) de la redéfinition des institutions moulées dans des « habitus » dictatoriaux, de l’invention des institutions réclamées par la « transition » et l’installation de la démocratie.
En d’autres termes, rien n’a été fait dans la mise en place d’un nouvel ordre symbolique politique, particulièrement dans la société haïtienne, elle qui a été en proie à des régimes despotiques ou dictatoriaux. Aujourd’hui la tendance s’inverse. Du processus à la démocratie, avant même la maturation de l’expérience démocratique, on en est au retour de/à la dictature. Que s’est-il passé ? Comment comprendre cette victoire à la Pyrrhus, qui semble faire de la démocratie, de la politique des « droits de l’homme » les dindons de la farce de la dictature?
Je testerai une hypothèse qui appelle une démonstration historico-conceptuel en ayant en arrière-fond des présupposés anthropologiques de l’imaginaire de la politique, particulièrement de l’imaginaire du pouvoir – politique – qui se consolide d’une relation indéfectible au divin, à la « noblesse », bref à l’ « aristocratie ». Le pouvoir est aristocratique par essence. Il est lié aux « dieux », à Dieu, au « sang », en tant que « sang noble » ou « pur », à la force guerrière en tant que cette force reçue des dieux soumet les hommes « vils » (serait-ce pour cette raison que le « peuple » serait compris comme de la « canaille » ?). Cet aspect montre déjà combien la démocratie s’est révélée fragile ou précaire, même dans les sociétés dites à démocratie avancée où se joue le simple jeu des droits postulés (droits à l’éducation= avec un système éducatif disparate, droits à la liberté d’expression= on peut parler sans être écouté ou entendu, par ailleurs les vies des « exploités » sont précarisées et vulnérabilisées, des dispositifs d’endettement des plus appauvris contrastent à l’enrichissement éhonté des plus enrichis, etc.).
Cette relation du pouvoir au sang noble, au divin, qui traverse l’imaginaire de la politique semble entraver le projet de la démocratie, du moins, semble le réduire à un vœu pieux où les attentes des citoyens sont devenues des rêveries politiques. Par ailleurs, cette même relation propose la raison pour laquelle le pouvoir semble se lier à certaines «familles» (il prend souvent la forme de la « familia » avec sa « cosa nostra »). D’où l’intérêt pour la forme aristocratique qui renvoie moins à une forme d’organisation sociale, politique ou anthropologique qu’à un imaginaire, sorte d’ « instituant symbolique », qui nourrit le pouvoir politique et lui donne sens et consistance en ayant la structure de la famille (lien de sang) comme signifiant.
Dans le cas de la société haïtienne, il y a eu une double détermination, celle de la communauté internationale et celle de la « bourgeoisie » haïtienne. Double détermination qui porte la marque aristocratique du sang (ou de la couleur épidermique), de la « race » ou de la colonialité. Cet état de fait me permet de supposer que le difficile avènement de la démocratie dans le cas haïtien est dû à la fois à la forme aristocratique du pouvoir dans l’imaginaire politique de l’occident (antique ou moderne) et à la double détermination racialiste et colonialiste du pouvoir en contexte postcolonial. Il faut prendre aussi en compte le « familialisme » comme modalité de partage et de gestion du pouvoir politique.
Le retour de la dictature, en plus d’être l’actualisation de l’imaginaire aristocratique, prend la forme de l’émiettement des « familles » qui occasionne l’émiettement du pouvoir politique. Sans aucun souci de nostalgie à l’égard d’une institution qui a causé beaucoup de méfaits à la société haïtienne, il est important de souligner que cet émiettement est dû à la dissolution de l’armée qui avait donné une certaine consistance au pouvoir autour d’une certaine convergence des intérêts familiaux traditionnels – et de ceux de nouvelles familles venues de « nulle part », qui se sont révélés aujourd’hui disparates, inconciliables ou difficiles à se maintenir ensemble. Ce sera là le sens du phénomène de gangstérisation qui est à la fois une forme de « retrait » et de « redéploiement » de l’état qui se revêt sans se masquer de sa forme mafieuse.
Enfin, prenant en compte le cas d’Haïti, je me propose d’argumenter l’idée selon laquelle le retour des pratiques dictatoriales n’est que la forme nouvelle de gouvernementalité, une autre forme de biolopolitique (zoopolitique) qui ne vise pas la mort effective, mais la mort miroitée au profit de la paix ou de la sérénité des intérêts des groupes d’intérêt nationaux et internationaux. Ce que retour dit c’est le caractère pérenne de la structure du pouvoir : le pouvoir est aristocratique. Il est contre le « peuple ».
La créativité du dire. Entre structure et genèse
La dernière fois, un collègue commentant le livre important de l’historien Délide Joseph, s’est interrogé sur la faiblesse d’épistémologie historique de sa démarche. Justifiant sa position, il avance qu’aucun découpage historique ou épocal n’est présent dans ce travail. Mon collègue termine, et c’était là le véritable enjeu de ses remarques, qu’il comprend difficilement l’appréciation de la Société Haïtienne d’Histoire, de Géographie et de Géologie, seule institution qui réunit certains historiens et tentent infructueusement de constituer la science historique en « champ ».
J’en viens à cette anecdote, question de rappeler qu’une compréhension de l’écriture historiographique semble s’imposer en Haïti ; elle est définie par la datation, la périodisation. Un autre collègue historien confie à un collègue philosophe qu’il comprend très peu ce que je fais, vu que je ne fais référence à aucune date, à aucune période. Remarque à laquelle mon ami philosophe se souscrit, puisque lui aussi m’a reproché ma manière de mobiliser l’histoire sans prendre en compte les « moments » historiques qui scanderaient l’historicité haïtienne. C’est presque dire que cette vision épistémologique de l’historiographie qui s’exprime silencieusement, puisqu’elle ne se dit pas dans aucune prise de conscience réfléchie et systématique, gagne un certain assentiment.
Face à cette exigence de l’historiographie haïtienne de prescrire une manière au philosophe de mobiliser, j’ai répondu que chez le philosophe, l’histoire est un matériau pour la conceptualisation des expériences humaines. Donc, c’est une prétention à relent autoritariste pour un historien de penser dire au philosophe comment s’introduire dans l’écriture de l’histoire.
Par ailleurs, je tiens à porter une autre forme d’explicitation de ma relation à l’histoire et mon usage de l’historiographie. Et c’est Derrida qui m’offre l’opportunité de développer une manière nouvelle de comprendre la logique de l’histoire. La première précision qu’exige cette nouvelle compréhension de l’histoire est celle de la distinction entre historiographie, l’écriture de l’histoire événementielle et la phénoménologie, qui est une manière de surprendre de la logique dans l’histoire, un regard de l’histoire comme événementialité, c’est-à-dire dynamique herméneutique de l’histoire. Cette distinction permet de prendre l’histoire comme le lieu de constitution où se mettent en place du constituant et du constitué.
En conséquence, j’en viens à la deuxième précision, l’histoire n’est pas seulement le récit ou la mise en intrigue des expériences humaines diverses, plurielles ou dispersées. Elle est une dynamique d’enchevêtrement de constituants et de constitués. Dans ma thèse de doctorat, déjà datée, j’ai défini cette dynamique par la tension entre « structure » et « genèse », que j’ai désignée de structurance. Ce n’est pas le moment de m’arrêter à ce « discours de la méthode » que j’ai élaboré pour comprendre la dynamique historique de la société haïtienne.
Eu égard à ma présente intervention, je tiens à ajouter un supplément, celui de l’histoire, entendue comme lieu de constitution, donc de l’histoire comme genèse inépuisable de sens depuis l’origine phénoménologique que la phénoménologie dégage de l’expérience historique.
Évidemment, mon concept d’origine n’a aucune valeur historique. Elle est loin d’être un commencement historique, même lorsqu’elle semble se greffer sur le commencement historique. En ce sens, Derrida se révèle génial et a fait un coup de maître. Commentant le livre de Husserl, l’ « origine de la géométrie », en faisant l’enjeu majeur de cette posture originale d’écrire phénoménologiquement l’histoire de la géométrie, il montre comment le phénoménologique se détache de l’historique. Cette histoire phénoménologique s’est révélée à l’arrivée une nouvelle manière d’écrire l’’histoire, celle de surprendre le sens génésique qui s’est installé depuis l’origine tout en prenant des formes diverses de manifestation dans son déploiement, que représente l’histoire. Cette phénoménologie de l’origine ne raconte pas des événements, puisqu’il n’y a eu qu’un événement, celui de l’origine subissant des variations.
Donc, le sens fondamental de ma relation à l’histoire est celui de suivre les variations de la « structure » à laquelle a conduit la « genèse » historique. Il est question en fin de compte de poser que les expériences humaines varient dans leur constitution, se constituent dans leurs variations. Je me suis souvent intéressé à suivre les manifestations de cette tension entre « genèse » et « structure ».
Telle est donc la posture que j’adopte ici. Penser la fragilité de la démocratie, c’est revenir à la constitution de la politique comme forme symbolique, comme production de sens. Ma perspective s’apparente à celle de Derrida. Je ne me dirige plus vers l’histoire comme commencement, mais au sens déposé depuis ce commencement qui devient la transcendantale de la forme symbolique en question, en l’occurrence à la politique. Et cette phénoménologie du pouvoir politique conduit davantage à une conception tragique de la politique où l’égalité se bat à la hiérarchisation. En ce sens la sociologie historique de l’État, l’anthropologie historique du pouvoir en général et du pouvoir politique en particulier, de la théologie politique occidentale sont d’un plus grand secours que la philosophie (politique).
Le pouvoir n’est pas humain. L’origine divine de la puissance
Marc Richir, mon accompagnateur de toujours, propose une compréhension de l’institution symbolique et phénoménologique de l’État en montrant, à partir de la société grecque, comment les mythes élaborés en mythologie et mythico-mythologie qui sont autant de manière de symboliser constituent des processus de transformation de la description de la puissance divine et du pouvoir des rois. Il s’agit donc du passage des dieux aux rois en passant par les héros, du mythologique au mythico-mythologique, de la communauté des dieux à celle des hommes, bien entendu, mêlés aux dieux. Trop riches, trop denses et parfois trop difficiles les arguments proposés par Richir pour les exposer ici. Encore que l’espace de mon intervention est limité. Je me contente de résumer espérant reprendre plus en détail les différentes étapes de l’argumentaire général lors de la publication des actes des deux journées. Sommairement, Richir, par son approche mythologico-phénoménologique, celle qui consiste à montrer la manière dont la puissance des dieux est ordonnée dans les mythologies et revenue « sauvage » dans le mythico-mythologique, montre que le pouvoir politique se fonde par la mise en retrait des dieux par les héros et les rois. Une mise à distance qui prend souvent la forme tragique du destin ou de la difficulté humaine à se dégager des dieux. Vu sous un autre angle, cette tension des hommes et des dieux indique que le pouvoir humain se révèle inséparable des dieux. Cela, que ce soit par le besoin humain de plus grande autonomie face aux dieux ou de celui de rendre la vie sociale ou politique vivable en rendant humaine la puissance divine d’où vient le pouvoir royal, les dieux sont incontournables même dans le procès de « sécularisation » de la modernité (Il faudrait prendre en compte la récurrence de considérations théologiques dans la philosophie politique de Hobbes ou de Locke). Un quelque chose de l’ordre de la nature, du divin ou de l’« affectivité » hante le pouvoir. C’est en son nom que l’État ou le pouvoir politique cherche à le mettre en retrait tout en agissant en son lieu et sa place.
Donc, le sens fondamental de ma relation à l’histoire est celui de suivre les variations de la « structure » à laquelle a conduit la « genèse » historique. Il est question en fin de compte de poser que les expériences humaines varient dans leur constitution, se constituent dans leurs variations. Je me suis souvent intéressé à suivre les manifestations de cette tension entre « genèse » et « structure ».
Cette pensée phénoménologico-mythologique de Richir me conduit à une considération plus anthropologique. En réalité, l’ordre symbolique mis en place par les mythes, les mythologies et les mytho-mythologies recèle une cosmogonie qui devient le cadre de compréhension de la socio-gonie et de la relation plus linéaire ou lignagère des dieux et des hommes. Dès lors, le pouvoir humain devient un dérivé du pouvoir des dieux. Le pouvoir est donc lié à un ordre cosmogonique de la puissance et de l’intelligence. Ce qui m’amène à une autre question que Richir s’est posée dans la présentation qu’il a faite du livre magistral de Schelling, Philosophie de la mythologie. Étudiant la langue comme la forme d’institution par excellence, Richir comprend Dieu ou les dieux comme « un instrument d’analyse de la langue, qui permet de la déplier, et de la déployer, de donner forme et sens à l’expérience humaine. » Si la langue représente le premier moment de l’institution symbolique, son déploiement dans les mythes et les mythologies où apparaissent les dieux permet de constater que ceux-ci marquent la souveraineté. Ils marquent une coupure entre l’homme et la nature tout en préservant la force sauvage, primitive de la nature. Les dieux sont fondateurs de la souveraineté ; garants et modèles de l’ordre humain ; ils se tiennent, comme le souverain humain, à la lisière du naturel et du social ou du symbolique.
Anthropologiquement, l’ordre social ou politique informé moins par la langue que par les mythes ou les mythologies se construit de la relation des hommes aux dieux ou du don des dieux aux hommes. Dans les deux cas, le pouvoir, celui du politique, est en commerce constant avec les dieux grâce auxquels il se revêt l’allure de distance, de puissance, de pureté et de transcendance. Le pouvoir est pur, transcendant ou distant et puissant. Vu sa liaison à la puissance des dieux qui sont des êtres naturels doués de grande raison, de grande sagesse, le pouvoir se lie aussi à la raison.
Théologiquement, le pouvoir est postulé comme venu de Dieu. Ainsi il est associé à une catégorie socio-historique, l’aristocratie, qui se définit comme étant l’homme meilleur par l’obtention lignagère des dieux des facultés les plus divines, la raison, l’intelligence, bref la noblesse. Le pouvoir politique s’apparente au pouvoir que les dieux exercent sur les hommes et le souverain humain n’a de compte à rendre qu’aux dieux. Entre les dieux et les hommes un ordre dégressif s’installe face aux hommes ordinaires, aux « peuples ».
Historiquement, la question de la politique se pose dans les termes de la distinction entre ceux qui sont aptes à diriger et ceux qui ne le sont pas. Partout ailleurs, la réponse reste la même. Ceux qui doivent diriger se sont ceux qui ont fait montre d’une grande aptitude intellectuelle et de courage. Ceux qui ont été plus amplement gratifiés des dieux. Le pouvoir politique a donc une intentionnalité, une éidétique, un sens fondateur, celui de l’aristocratie, de la noblesse de sang, de rang ou d’intelligence comme attribut de l’homme meilleur, apte à prendre en charge le destin des choses du monde, en tant ces choses sont les choses des dieux.
Toute la problématique théologico-politique, que même la tradition de la philosophie moderne de la fondation humaine ne parvient pas à éradiquer, toute l’historiographie des « rois thaumaturges » ou des « deux corps du roi » en s’arrêtant au concept théologique de la souveraineté que l’on attribue à juste titre et paradoxalement au peuple, ne cessent de reprendre de se battre à cette insistante présence du divin.
En effet, le peuple est souverain comme autrefois les dieux. Il s’interpose dans l’ordre politique entre la force de la nature et l’ordre qu’il ne saurait instituer. C’est la raison pour laquelle, il se fait représenter par les plus doués. Se présente tout le paradoxe de la démocratie, rabattue à la liberté d’expression ou de conscience, alors que les décisions, les orientations fondamentales sont laissées aux « experts », qui se trouvent à la solde des nouveaux aristocrates, des aristocrates des temps modernes qui ne se définissent pas seulement par le sang, mais par l’argent.
L’arsitocratisme de la démocratie et le pouvoir illusoire du « peuple »
Qu’est-ce que l’aristocratie ? Et en quoi la démocratie, l’institution du peuple comme instance de souveraineté ou de puissance politique ne se débarasse pas par trop grande différence de l’aristocratie ? La démocratie camoufle son aristocratisme, sa passion du pouvoir détenu par les fils des dieux, pourvus des facultés nobilaires de puissance, d’intelligence ou de ruse, de secret ou de mise en scène. Comment dire cet aristocratisme de la démocratie ?
Dans la tradition de la philosophie politique l’aristocratie est souvent comprise comme un système politique à côté d’autres. En ce sens, elle est comprise comme le gouvernement, système de gestion de la communauté par les meilleurs parmi les humains.
Or, l’anthropologie historique de la politique, cette description historique de la politique comme forme symbolique, montre que les meilleurs parmi les hommes seraient d’ascendance divine, héroïque ou titanesque. L’aristocratie n’est donc pas seulement un système de gestion de la communauté politique par un groupe d’êtres d’exception. Elle a fini par désigner ce groupe social, habilité, par ses facultés extraordinaires de l’intelligence, par la noblesse de sa « race » moulée dans le « sang pur » de la divinité à prendre en main les affaires des dieux face aux hommes du monde. Donc l’aristocratie n’est pas seulement un régime politique qui s’est imposé dans un contexte historique et culturel au cours duquel les hommes vivaient avec les dieux mais traduit ce qui est consubstantiel à la fondation du pouvoir ou du pouvoir politique. Il n’y a pas de pouvoir qui ne soit aristocratique. Il est de l’essence du pouvoir d’être aristocratique, puisqu’en dépit du principe d’égalité postulé par la philosophie, le pouvoir ne cesse de revendiquer des hommes aux facultés exceptionnelles. Le pouvoir en général ainsi que le pouvoir politique se fait avec les hommes d’exception.
La démocratie n’est pas en reste. On se rappelle les objections de Rousseau sur la démocratie directe, celle où le « peuple » aurait fait proprement l’expérience de la participation aux décisions publiques sans transiter par les facultés supérieures de ses représentants. C’est à certains égards que Rousseau se résout à constater la difficulté d’une expérience de la démocratie sans la « représentation », sans l’institution d’une « aristocratie élective » qu’il considère comme un moindre mal face à l’ « aristocratie naturelle » ou « héréditaire », surtout en réponse à l’impossibilité de la démocratie directe. « Il est contre l’ordre naturel que le grand nombre gouverne et que le petit nombre soit gouverné ». En réalité, une telle expérience de la démocratie n’est pas impossible. Il apert que sa possibilité concerne le monde des dieux. « S’il y avait un monde de dieux, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. » Autrement dit, le peuple au cas où l’on parviendrait à le trouver est incapable de se diriger. L’impasse de la démocratie directe est dans la nature même du pouvoir qui est aristocratique. Il est appelé à élire, à choisir les meilleurs. Rousseau, encore une fois, rappelle que « c’est l’ordre le meilleur et le plus naturel que les plus sages gouvernent la multitude. » Que doit-on entendre par les « plus sages » ? Il s’agit de ceux parmi le peuple faisant un meilleur ou un plus grand usage des facultés divines, de la raison particulièrement. Durkheim a repris à son compte une position similaire. Il est convaincu comme Rousseau que « toute société se doit dirigée par une minorité consciente et réfléchie ». Il est bien entendu que l’aristocratisme de la démocratie est incontournable. Mal nécessaire de la démocratie qui, ayant voulu se défaire de l’essence du pouvoir politique, se voit rattrapée par l’aristocratisme.
L’aristocratisme de la démocratie prend la forme de la dérision que l’aristocratie tourne la démocratie qui a pensé s’échapper du naturel du pouvoir. Il faut préciser que cet aristocratisme ironique de la démocratie ne dit pas que la démocratie soit annulée, qu’elle soit impraticable. C’est aller vite en besogne de le considérer comme un anti-démocratisme. Il se veut vigilant, prudent et éveillé contre l’aspect euphorisant du démocratisme qui se fait évangile du salut politique.
Rappeler que l’aristocratie gît au cœur de la démocratie par nécessité naturelle du pouvoir politique c’est se demander en quoi le peuple aurait-il le pouvoir de gouverner. C’est tenter de sortir de l’illusion politique qui consiste à mettre le « peuple » en scène, dans une dramaturgie baroque, où il est plus joué qu’il joue. Le peuple est un agent non agissant mais agi par le point de vue divin que tiennent sur lui les grandes familles financières, les grandes machines de communication ou de manipulation, les grands faiseurs de roi.
Ce que l’on appelle la « classe politique » qui mérite une sociologie plus élaborée et riche que la sociologie des partis politiques n’est que la recomposition de la « famille » politique, de la classe des élites qui se décident de la vie politique, des agendas politiques et du tempo à donner au peuple par la gestion de sa vie économique. Certains objecteront en reconnaissant qu’en démocratie que les mobilités sociales permettent de résorber les inégalités et profiter de l’ « égalités de l’intelligence ». Ils diront que la démocratie crée les conditions de la prise de parole autonome, de la libre expression, du choix de ses convictions et croyance. J’ai un profond malaise à comprendre cet optimisme face à la démocratie. Du moins, celui-ci semble traduire l’état d’esprit d’une civilisation traumatisée par le totalitarisme et se jette dans les bras impuissants du démocratisme qui ne cesse de se muer en dispositif de contrôle. Il n’est pas vrai qu’en démocratie que la parole soit libérée. Et cette liberté ne concerne même pas encore le fait de dire ce que l’on veut. Mais ce qui est dans les limites de la légalité. Il n’est pas vrai que le peuple soit souverain. Il est pour lui un défi colossal de destituer ses représentants sur lesquels il n’a qu’une emprise électorale périodique. La raison d’état montre combien le pouvoir politique, une fois institué avec les dieux, crée son lieu secret ou de grande raison pour s’échapper du peuple et faire du « demos » non le détenteur du « kratos ». Il n’y a dans cette dérision ou dans cette euphorie qu’un oubli, celui de l’arkhè. Le kratos ne s’institue pas de lui-même. L’arkhè qui est commencement et commandement dit clairement que ce qui se trouve au commencement, à l’origine, en compagnie des dieux dirige. Tel est le sens du pouvoir aux dieux et à l’aristocratie, qui ne cesse de jouer à la démocratie de mauvais tour et font des démocrates impénitents des fossoyeurs d’espérance du « peuple ».
J’espère qu’on a bien compris que ma préoccupation n’a pas été celle de proposer l’anti-démocratie comme figure du pouvoir politique et donner libre cours aux passionnés de pouvoir autoritaire. Ma démarche n’appelle pas le dualisme démocratie/dictature ou despotisme. Elle est plutôt, du point de vue phénoménologique nourri d’anthropologie, de symbolique, de mythes, de mythologie et mytho-mythologie et de théologico-politique, que la démocratie gomme son essence pour se jouer de la tête du « peuple » qui ne cesse d’être « introuvable ».
Rappeler que l’aristocratie gît au cœur de la démocratie par nécessité naturelle du pouvoir politique c’est se demander en quoi le peuple aurait-il le pouvoir de gouverner. C’est tenter de sortir de l’illusion politique qui consiste à mettre le « peuple » en scène, dans une dramaturgie baroque, où il est plus joué qu’il joue.
En prenant cette voie, je me propose de rendre les citoyens attentifs à cette illusion politique qui vise à faire croire que le pouvoir est au « peuple », alors que le pouvoir est de nature aristocratique. N’est-ce pas pour cette raison que le pouvoir ennoblit, rend visible et habite le lieu de la hauteur et se donne en spectacle. Tous ces rappels n’ont eu qu’une préoccupation : penser que la démocratie n’est possible qu’en mettant à mort les dieux. Le peuple ne pourra pas advenir tant que les dieux existent, puisque ce sont les dieux, illusoires ou non, qui rendent possibles des ayant droit qui revendiquent le pouvoir par leur sang, par leur science et leur argent.
Et ces héritiers des dieux vampirisent le « peuple » comme les dieux sucent les énergies du « peuple », lequel se perd en espérance et perd la puissance d’agir. Il faut sortir du théologique, du mythique ou mythologico-politique, pour instituer la puissance humaine dans sa plénitude. Là encore aucune garantie que la politique soit possible. On peut toutefois croire que le « peuple » en proie avec lui-même ne se laissera pas siphonner par les héritiers des dieux.
Par : Edelyn DORISMOND
Professeur de Philosophie au Campus Henry Christophe de Limonade et également à l’École Normale Supérieure de l’Université d’État d’Haïti.
Ex Directeur de Programme au Collège Internationale de Philosophie
Responsable de l’axe 2 au LADIREP
Couverture : Concept de collage sur la dictature et l’oppression. Source : Freepik
► AyiboPost s’engage à diffuser des informations précises. Si vous repérez une faute ou une erreur quelconque, merci de nous en informer à l’adresse suivante : hey@ayibopost.com
Gardez contact avec AyiboPost via :
► Notre canal Telegram : cliquez ici
►Notre Channel WhatsApp : cliquez ici
►Notre Communauté WhatsApp : cliquez ici




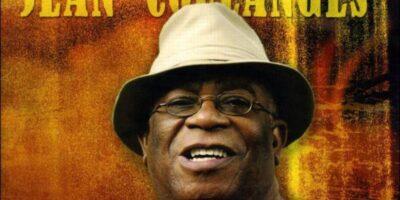

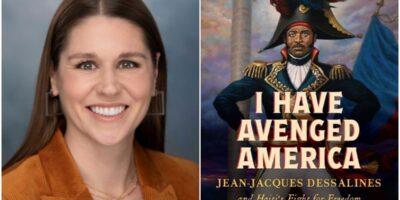
Comments