La plupart bouches d’incendie de P-au-P sont rouillées, obstruées ou carrément recouvertes par l’asphalte lors de travaux de voirie improvisés, selon les constats d’AyiboPost
Sur sept bouches d’incendie existant dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, une seule est encore fonctionnelle.
Les bouches d’incendie — également appelées hydrants, bornes-fontaines ou poteaux d’incendie — sont des dispositifs essentiels de lutte contre le feu. Reliées à un réseau aérien ou souterrain, elles constituent des prises d’eau sous pression qui permettent d’alimenter directement les fourgons des sapeurs-pompiers.
Les bouches d’incendie représentent un élément crucial de toute infrastructure urbaine pour protéger la population contre les incendies, explique Jeff Georges, commandant au sein du Service d’Incendie de la Mairie de Port-au-Prince (SIM-PAP).
Une ville dépourvue de ces matériels de secours indispensables offrant un accès rapide et direct à l’eau est donc vulnérable.
Dans de nombreux pays, il existe une réglementation technique claire encadrant l’installation et le fonctionnement des bouches d’incendie.
Lire plus : Le service d’incendie de Port-au-Prince meurt à petit feu
En Haïti, aucune disposition officielle ne statue sur la question. Le Code National du Bâtiment d’Haïti (CNBH) aborde certains aspects liés à la protection contre l’incendie, mais ne fait aucune mention explicite des infrastructures telles que les bouches d’incendie.
Dans les rues poussiéreuses et encombrées de Port-au-Prince, il est difficile de remarquer la présence des anciennes bouches d’incendie.
Selon les constats d’AyiboPost, la plupart sont rouillées, obstruées ou carrément recouvertes par l’asphalte lors de travaux de voirie improvisés.
Sur sept bouches d’incendie existant dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, une seule est encore fonctionnelle.
Parmi les bouches d’incendie encore visibles dans la juridiction, le responsable de la SIM-PAP cite celles de Magloire Ambroise (dans les environs de Carrefour-Feuilles), de la rue Oswald Durant, de la rue Roy, de l’avenue Magny, de la route de Bourdon, de Turgeau et de la rue Marcadieu.
« Mais sur toutes ces installations, une seule reste fonctionnelle : celle de Turgeau, qui fournit de l’eau uniquement trois fois par semaine, de 7 heures à 9 heures du matin », précise Georges.
La situation n’est guère différente dans les communes avoisinantes de Port-au-Prince.
À Delmas, Joasil Jean Ronald, commandant du Corps des pompiers et du centre d’urgence de la mairie de Delmas, reconnaît ne pas disposer de chiffres exacts sur le nombre de bouches d’incendie présentes dans la commune. Il estime qu’il en existe une dizaine, mais précise qu’aucune n’est fonctionnelle.

Photo : Jean Feguens Regala
À Pétion-Ville, même constat. Maxo Joachim, commandant du Corps des pompiers de la mairie, ne se souvient pas de l’emplacement exact des bouches d’incendie de la commune. « Il est difficile de les retrouver, car certaines sont obstruées par des immondices ou recouvertes par des activités de rue, qu’il s’agisse de commerce ou de stations-service », explique-t-il.
Joachim se rappelle toutefois en avoir vu deux : l’une située rue Métellus, à proximité de la Direction nationale de l’eau potable et de l’assainissement d’Haïti (DINEPA), et une autre dont il ne se souvient plus de l’adresse exacte. « Celle qui est proche de la DINEPA peut encore fournir de l’eau, mais seulement si l’on fait la demande à la DINEPA pour qu’elle soit ouverte », ajoute-t-il.
Un résident de la commune de Carrefour rapporte à AyiboPost l’existence d’une bouche d’incendie située dans les environs de Diquini 63. « Je ne crois pas qu’elle fonctionne, et il faut vraiment être attentif pour la remarquer, car elle se trouve au milieu des marchands installés le long de la rue », décrit ce résident, qui dit ne pas se souvenir d’en avoir vu d’autres dans la commune.
À Delmas, Joasil Jean Ronald, commandant du Corps des pompiers et du centre d’urgence de la mairie de Delmas, reconnaît ne pas disposer de chiffres exacts sur le nombre de bouches d’incendie présentes dans la commune. Il estime qu’il en existe une dizaine, mais précise qu’aucune n’est fonctionnelle.
En 2019, la DINEPA, avec un financement de la Banque interaméricaine de développement (BID), avait prévu l’installation de 125 bouches d’incendie dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, afin de garantir la disponibilité de l’eau en cas de sinistre. Mais ce projet n’a jamais vu le jour.
AyiboPost n’a pas pu obtenir d’éléments concrets sur l’état de cette initiative.
Mais cette situation n’est pas isolée. Elle constitue plutôt la partie visible du fonctionnement du secteur des services d’incendie en Haïti, un domaine davantage fragilisé par l’insécurité généralisée et l’absence d’encadrement.
Placés sous la tutelle de la Police nationale d’Haïti (PNH), les services d’incendie du pays évoluent dans un cadre extrêmement précaire.
Cette réalité, combinée aux conditions de travail difficiles des sapeurs-pompiers, s’inscrit dans un contexte où plusieurs quartiers de Port-au-Prince demeurent particulièrement vulnérables face au risque d’incendie.
Jeff Georges, commandant de la caserne du SIM-PAP depuis décembre 2024, décrit à AyiboPost la dure réalité du quotidien de ses hommes et femmes.
« Nous travaillons dans un contexte extrêmement difficile, marqué non seulement par les problèmes d’alimentation en eau, mais aussi par l’insécurité », explique-t-il.
Placés sous la tutelle de la Police nationale d’Haïti (PNH), les services d’incendie du pays évoluent dans un cadre extrêmement précaire.
Les interventions se déroulent souvent dans des conditions à haut risque. « Nous n’avons pas de gilets pare-balles, ni de véhicules blindés. Il arrive que nous soyons appelés sur des terrains où la police affronte directement des bandits », poursuit Georges.
Il raconte notamment une expérience survenue il y a deux semaines, dans les environs de Babiole.
Ce jour-là, ses hommes ont dû intervenir à pied pour éteindre un incendie déclenché par des bandits dans trois habitations, alors même que des échanges de tirs retentissaient tout autour.
Joasil Jean Ronald, responsable du Corps des pompiers de Delmas, reconnaît que le champ d’action de son équipe est aujourd’hui considérablement réduit par rapport aux années précédentes.
« Autrefois, l’équipe pouvait intervenir dans l’ensemble des zones environnantes — que ce soit à Cité-Soleil, dans le bas de Delmas ou dans d’autres quartiers voisins. Mais aujourd’hui, ce n’est plus possible. Nous devons limiter nos interventions aux endroits où la vie de nos hommes n’est pas directement menacée, car nous ne sommes pas armés et nos véhicules ne sont pas blindés », explique Jean Ronald.

Photo : Jean Feguens Regala
Il se souvient d’un incident particulièrement marquant, en décembre 2024, qui a failli coûter la vie à huit de ses sapeurs-pompiers. « On nous avait signalé un incendie à l’Hôpital Bernard Mevs. Après avoir fait diligence pour maîtriser le feu, nous avons été pris en embuscade par des bandits qui se trouvaient encore sur les lieux », raconte-t-il. « Nous nous en sommes sortis de justesse », ajoute-t-il.
Le secteur n’est pas seulement fragilisé par l’insécurité, mais aussi par un manque criant de moyens de fonctionnement.
Pour s’approvisionner en eau, le SIM-PAP est contraint de parcourir près de douze kilomètres, jusqu’au boulevard du 15 Octobre à Tabarre, afin de remplir ses camions.
Une opération qui peut se répéter plusieurs fois par jour, dès lors que plusieurs incendies se déclarent et que les réservoirs se vident. Le parc automobile de la caserne ne dispose en effet que de deux fourgons : l’un d’une capacité de 3 500 gallons et l’autre de 1 000 gallons.
« À chaque fois qu’un incendie éclate, la scène se répète : les pompiers arrivent rapidement, mais leurs camions vétustes se vident en quelques minutes. Les citernes embarquées ne peuvent contenir qu’une quantité limitée d’eau. Une fois vides, il faut repartir à la recherche de nouveaux points d’approvisionnement. Or, il n’en existe pratiquement pas dans la capitale », explique le commandant Georges.
« Autrefois, l’équipe pouvait intervenir dans l’ensemble des zones environnantes — que ce soit à Cité-Soleil, dans le bas de Delmas ou dans d’autres quartiers voisins. Mais aujourd’hui, ce n’est plus possible. Nous devons limiter nos interventions aux endroits où la vie de nos hommes n’est pas directement menacée, car nous ne sommes pas armés et nos véhicules ne sont pas blindés », explique Jean Ronald.
Il était deux heures du matin, il y a quelques mois, lorsqu’un incendie s’est déclaré à Lalue. « Nous avons sollicité la mairie de Delmas, mais aucune équipe n’a pu intervenir, faute d’autorisation pour se déplacer à cette heure-là. C’est grâce à la collaboration de la population que nous avons finalement pu maîtriser le feu », poursuit Georges.
Le cas du Corps des pompiers de la mairie de Pétion-Ville est encore plus préoccupant.
Selon Maxo Joachim, responsable de l’institution depuis huit ans, le dernier fourgon d’incendie encore opérationnel est tombé en panne il y a environ huit mois. « Si un incendie éclate dans la commune de Pétion-Ville, nous, en tant que corps de pompiers installé ici, ne pourrons tout simplement pas répondre. »
D’après ses explications à AyiboPost, la mairie de Pétion-Ville ne disposait que de deux fourgons. Aujourd’hui, aucun n’est fonctionnel. « La caserne est mal équipée, ses infrastructures sont inachevées, il n’y a même pas d’eau sur place pour l’entretien personnel des sapeurs-pompiers, et aucune nourriture quotidienne n’est fournie », décrit Joachim, qui dirige une équipe de dix-neuf pompiers sous sa responsabilité.
À ces conditions de travail déjà précaires s’ajoute un accompagnement social quasi inexistant pour les professionnels du feu. Les pompiers de Port-au-Prince se décrivent eux-mêmes comme des « soldats sans armes ».
Le travail des pompiers ne se limite pas à la lutte contre les incendies. Ils interviennent également lors d’accidents de la route ou de catastrophes naturelles, pour ne citer que quelques exemples.
Mais leur action reste largement limitée en raison du manque de matériel.
« On ne dispose pas d’outils essentiels de désincarcération, indispensables lors d’interventions sur des accidents de la route », d’après Georges.
Mais ce sont surtout les conditions humaines qui frappent. Un pompier de base perçoit entre 17 000 et 25 000 gourdes par mois, soit l’équivalent de 130 à 190 dollars américains — une somme dérisoire dans un pays où l’inflation a fait flamber le prix des denrées de première nécessité. Avec un tel salaire, il est presque impossible de couvrir les besoins élémentaires d’une famille, d’envoyer ses enfants à l’école ou de payer un loyer.
« Nous risquons nos vies pour protéger les autres, mais personne ne se soucie de notre survie », confie Richardson Théogène, sapeur-pompier depuis six ans à la SIM-PAP.
À ce maigre revenu s’ajoute l’absence totale de couverture sociale. Les pompiers qui se blessent lors d’une intervention doivent assumer seuls les frais médicaux, souvent exorbitants par rapport à leur niveau de vie. Aucun système d’assurance maladie ne les protège. « Si nous tombons malades ou que nous nous blessons en service, il faut parfois compter sur la contribution des collègues pour trouver de l’argent. Sinon, nous restons sans soins », raconte Georges.
« Nous ne recevons aucune aide de l’État », poursuit-il.
Selon Richardson Théogène, père de famille, réussir à mettre de côté un peu d’argent n’est possible que grâce à la mise en commun de leurs revenus entre collègues.
Théogène vit exclusivement de son métier de sapeur-pompier. « Cela fait plusieurs mois que l’État ne fournit plus de nourriture dans les casernes », ajoute le professionnel, qui, selon ses horaires, passe plusieurs jours par semaine, 24 heures d’affilée, à la caserne.
Lire aussi : Les déchets, une nouvelle source de revenus pour les gangs à P-au-P
Les conséquences de ces conditions de travail précaires sont visibles. Ces dernières années, Port-au-Prince a été le théâtre d’une succession d’incendies dévastateurs. On peut citer : l’incendie ravageur du marché Hippolyte en 2016 ou celui du grand marché de La Croix-des-Bossales en 2017.
Dans la pratique, la gestion des pompiers relève des différentes municipalités, alors qu’en théorie elle dépend de la Police nationale d’Haïti.
« Le secteur des pompiers est généralement traité en parent pauvre. Il est laissé à lui-même, sans direction générale responsable pour l’ensemble du pays. Chaque municipalité agit de son côté, ce qui crée une véritable discordance dans le fonctionnement global du secteur », constate Joachim, qui plaide pour la création d’une direction nationale pour l’encadrement des pompiers en Haïti.
Dans un article publié en 2020, AyiboPost avait décrit les dysfonctionnements du quartier général du service d’incendie de Port-au-Prince, laissé à l’abandon, dans la crasse et le manque de moyens. Situé rue Légitime, à proximité du Champ de Mars, ce site se trouve aujourd’hui dans une zone sous contrôle de gangs.
L’État central, de son côté, n’a jamais mis en place de politique nationale de prévention et de lutte contre les incendies.
Par : Lucnise Duquereste
Couverture | Corps des pompiers et du centre d’urgence de la mairie de Delmas. Photo : Jean Feguens Regala
► AyiboPost s’engage à diffuser des informations précises. Si vous repérez une faute ou une erreur quelconque, merci de nous en informer à l’adresse suivante : hey@ayibopost.com
Gardez contact avec AyiboPost via :
► Notre canal Telegram : cliquez ici
►Notre Channel WhatsApp : cliquez ici
►Notre Communauté WhatsApp : cliquez ici

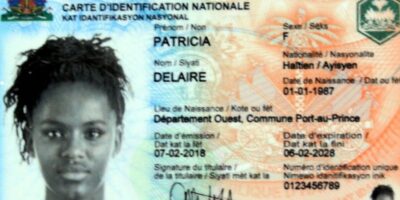





Comments