La nation est à genoux, humiliée dans le sang et la honte, confrontée à une vague de violences impitoyables sans précédent qui sape la sécurité, les moyens de subsistance et la stabilité sociale des citoyens. De plein fouet, le pays affronte en fait une menace existentielle
Comme le rapportent plusieurs médias du pays, les communes de l’aire métropolitaine de Port-au-Prince et dans les départements de l’Artibonite et du Centre sont contrôlées par des groupes criminels terroristes sans foi ni loi et sans aucune idéologie politique explicite.
La nation est à genoux, humiliée dans le sang et la honte, confrontée à une vague de violences impitoyables sans précédent qui sape la sécurité, les moyens de subsistance et la stabilité sociale des citoyens. De plein fouet, le pays affronte en fait une menace existentielle.
Face à cette intensification de l’insécurité généralisée et de la présente guérilla des terroristes, des voix s’élèvent, tant en Haïti qu’au sein de la diaspora, pour appeler à une résistance armée organisée aux côtés de la police et de l’armée, en sus de « Bwa Kale », des Kenyans et des mercenaires internationaux contractés par le gouvernement.
Pour qu’une telle résistance puisse se renforcer pour restaurer progressivement la sécurité et la paix du pays, il est impératif d’explorer les moyens financiers disponibles.
C’est assurément dans cet esprit que le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé se rend le 11 juillet 2025 à Washington D.C., dans l’espoir d’acquérir une « aide adaptée » des États-Unis pour contrer le carnage des gangs. Cette aide, si elle s’obtient éventuellement, pourra assurément se définir sous plusieurs angles : économique, matériel, formation militaire antiguérilla, formation policière, et peut-être même accompagnement américain des « military advisors » (conseillers militaires) comme dans les conflits militaires au Vietnam ou en Afghanistan.
Pour qu’une telle résistance puisse se renforcer pour restaurer progressivement la sécurité et la paix du pays, il est impératif d’explorer les moyens financiers disponibles.
Mais, le plus important aspect, comme toujours, prendra la forme des sommes sonnantes et trébuchantes pour supporter ce qui doit être les stratégies de défense armée et d’offense acharnée contre les gangs, privilégiant la neutralisation systématique de leurs chefs aussi bien sur le champ de bataille que dans la machination des stratégies criminelles. Ne dit-on pas souvent que le poisson pourrit par la tête ? Cependant, une judicieuse question s’impose : doit-on constamment, au prime abord, rechercher une aide financière auprès des Américains ou de la communauté internationale pour nos défis nationaux ?
Face à cet enjeu sécuritaire, pour préserver le droit fondamental à la vie et la jouissance de notre liberté inaliénable, la diaspora haïtienne, composée de millions de personnes résidant aux États-Unis, au Canada, en France et ailleurs, représente une source essentielle de soutien financier pour le pays. Selon les estimations, les transferts de fonds des Haïtiens à l’étranger ont atteint plus de 3 milliards de dollars par an ces dernières années (Banque mondiale, 2023).
Un pourcentage de cet important flux d’argent pourrait potentiellement être réaffecté au financement d’une résistance armée organisée visant à démanteler radicalement les gangs terroristes. Une version de la récente feuille de route pour résoudre la crise haïtienne de l’OEA évoque 900 millions de dollars américains pour l’humanitaire et 96 millions pour la stabilisation de la sécurité et le rétablissement de la paix. La dernière somme représente environ 3 % des transferts de la diaspora en 2023.
Même quand l’OEA obtiendrait ce montant des pays contributeurs, nous savons tous que la somme entière ne sera pas attribuée directement à la stabilisation sécuritaire, car il faut payer grassement les experts internationaux et les coûts de la logistique. Cependant, selon l’éditorialiste du Nouvelliste Frantz Duval, ce budget spécifique pour la stabilisation sécuritaire choque en paraissant dérisoire face à l’immensité du défi sécuritaire.
Et comme souvent dans le passé, une grande partie de cet argent retournera aux pays donateurs, renforçant la réflexion sur l’aide internationale qui n’aide pas. Par contraste, l’aide directe haïtienne peut avoir la vertu d’aider directement et efficacement les citoyens, sans lourdeurs administratives contrôlées par l’étranger. Cette aide directe peut s’obtenir a priori sur les transferts monétaires.
L’exemple notoire d’une captation d’un pourcentage des transferts monétaires par l’État est bien le fameux prélèvement de 1,50 dollar sur tous transferts, pris sous la présidence de Michel Martelly pour alimenter un fonds pour l’éducation. Il faudrait être un journaliste-investigateur bien connecté et futé pour trouver, pour l’année 2024 par exemple, le montant exact de cette somme – une donnée qui serait fortement appréciable. Quoi qu’il en soit, nul besoin d’être comptable pour savoir que ce doit être une imposante somme d’argent disponible immédiatement. Pourquoi ne pas la réaffecter à la sécurité nationale, qui logiquement est la priorité des priorités ?
Une autre source financière peut également s’obtenir majoritairement de la diaspora. Puisqu’il est clairement établi que l’un des éléments clés de la résistance armée est le financement, il est essentiel de mobiliser des expatriés haïtiens patriotes prêts à investir dans des mesures de défense et de contre-guérilla. De Cicéron, nous savons que le nerf de la guerre est l’argent.
En mutualisant leurs ressources, les communautés de la diaspora et les citoyens progressistes du pays peuvent mettre en place une infrastructure financière solide, capable de soutenir une résistance armée nationale. Toutefois, il est primordial que toute résistance de ce type respecte le droit international et accorde la priorité à la sécurité des civils afin d’éviter de nouvelles pertes collatérales de victimes innocentes. Nous ne pouvons nous abaisser à être barbares avec les barbares !
L’exemple récent et percutant d’une telle « konbit » financière est l’engagement spontané des contributeurs de la diaspora et du pays pour construire le canal de Ouanaminthe, réunissant une somme d’un million de dollars américains et 43 millions de gourdes en octobre 2024. Après le séisme dévastateur de 2010, ce fut le plus important mouvement de solidarité entre Haïtiens. Similairement, la diaspora et les citoyens du pays peuvent jouer un rôle multiforme dans une initiative sécuritaire de résistance armée.
De surcroît, à l’aide financière, les spécialistes de la sécurité, expatriés et locaux, pourraient collaborer avec des organisations de la société civile pour dispenser des formations pour le désarmement, la résolution de conflits et la planification stratégique d’une société pacifique. Cette symbiose pourrait non seulement donner aux citoyens les moyens matériels pour résister à la tyrannie et la sauvagerie actuelles des gangs, mais aussi favoriser la création d’une société civile plus structurée et durable. Le Centre d’analyse et de recherche en droits de l’homme (CARDH), dans l’organisation de sa récente table sectorielle sur la sécurité, a offert, dans cet ordre d’idées, des ateliers de réflexions intéressants, ce qui est à féliciter.
De plus, les répercussions politiques d’une position unie entre les résistants du pays et les financiers de l’extérieur pourraient être profondes. En se mobilisant et en démontrant leur engagement en faveur du rétablissement de la paix et en supportant économiquement la résistance armée locale, je gage que la pression sur les organisations internationales et les gouvernements étrangers s’amplifiera organiquement afin qu’ils coopèrent à prendre des mesures concrètes pour aider à stabiliser la situation en Haïti. L’histoire montre que le soutien international peut faire pencher la balance, notamment lorsqu’il vise à s’attaquer aux causes profondes de la violence plutôt qu’à ses seuls symptômes (International Crisis Group, 2023).
L’exemple récent et percutant d’une telle « konbit » financière est l’engagement spontané des contributeurs de la diaspora et du pays pour construire le canal de Ouanaminthe, réunissant une somme d’un million de dollars américains et 43 millions de gourdes en octobre 2024.
Ce ne sera pas seulement le modèle des dons de dizaines de véhicules tout-terrain et de blindés, ainsi que des armes et munitions à la Police nationale d’Haïti et aux Forces armées d’Haïti, offerts principalement par les États-Unis, la France et le Canada et estimés à plus de 80 millions de dollars américains entre 2021 et 2024, selon Le Nouvelliste.
Mais il s’agira aussi d’offrir un appui sécuritaire de plus haut niveau tel : une surveillance accrue pour empêcher le trafic d’armes illégales et les flux financiers illicites transnationaux associés aux gangs terroristes, ajoutée à une surveillance adéquate de la frontière terrestre avec la République dominicaine et les ports maritimes du pays.
En conclusion, les défis auxquels Haïti est confronté aujourd’hui sont considérables, mais grâce à un effort collectif et à un engagement financier pour une résistance armée contre les gangs, tant au sein du pays que dans la diaspora, une sortie salvatrice de cette crise sécuritaire peut s’accomplir.
L’unité, la détermination et les ressources des Haïtiens du monde entier doivent converger vers un effort concerté, visant non seulement une action militaire, mais aussi une paix durable et la reconstruction d’une nation fondée sur la dignité, la sécurité et l’égalité des chances pour tous ses citoyens. La paix se finance – « lajan an nan pòch nou » !
Par : Patrick André
Courverture | Une voiture brûlée sert de barricade dans une rue de Port-au-Prince. Photo : UNOCHA/Giles Clarke
► AyiboPost s’engage à diffuser des informations précises. Si vous repérez une faute ou une erreur quelconque, merci de nous en informer à l’adresse suivante : hey@ayibopost.com
Gardez contact avec AyiboPost via :
► Notre canal Telegram : cliquez ici
► Notre Channel WhatsApp : cliquez ici
► Notre Communauté WhatsApp : cliquez ici

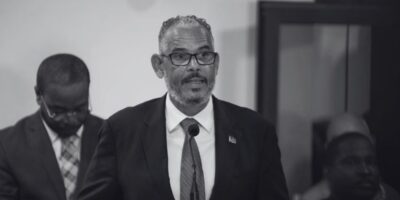



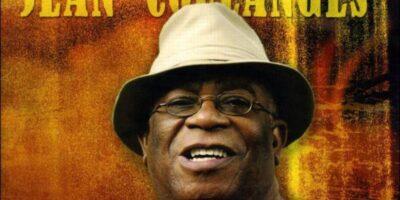

Comments