Beaucoup considèrent les politiques de l’administration Trump comme incohérentes, mais un examen plus approfondi révèle quelque chose de bien plus délibéré : une stratégie systématique qui déguise la cruauté en gouvernance raisonnable
Le 24 juin, l’ambassade des États-Unis en Haïti a émis une alerte de sécurité sévère, conseillant aux citoyens américains de ne pas se rendre en Haïti et exhortant ceux qui s’y trouvaient déjà à quitter le pays immédiatement. L’avertissement était si sévère que le personnel du gouvernement américain s’est vu interdire tout vol commercial en raison des « risques potentiels pour le trafic aérien ».
Pourtant, deux jours plus tard, le Département de la Sécurité intérieure a annoncé la fin complète du statut de protection temporaire pour Haïti, affirmant que « la situation sur le terrain en Haïti s’est suffisamment améliorée pour que les citoyens haïtiens puissent rentrer chez eux en toute sécurité ».
Cette décision affecte plus de 500 000 Haïtiens qui bénéficiaient de ce programme de protection.
Beaucoup considèrent les politiques de l’administration Trump comme incohérentes, mais un examen plus approfondi révèle quelque chose de bien plus délibéré : une stratégie systématique qui déguise la cruauté en gouvernance raisonnable.
La suppression du statut de protection temporaire (TPS) pour les Haïtiens n’est pas un cas isolé. Elle s’inscrit dans une démarche plus large visant à effacer les personnes noires et métisses de l’histoire américaine.
Cette purge silencieuse ne se limite pas à Haïti et se déroule sur plusieurs fronts. Il se manifeste dans la suppression des pages du Service des parcs nationaux concernant Harriet Tubman et le chemin de fer clandestin, la suppression de l’histoire du service militaire de Jackie Robinson pendant la purge DEI (Diversité, Équité et Inclusion) du Pentagone et le changement de nom des navires de la Marine qui honorent les leaders des droits civiques comme Thurgood Marshall et Medgar Evers.
Il ne s’agit pas d’actes aléatoires. Ce sont des mesures soigneusement coordonnées qui s’inscrivent dans un plan plus vaste visant à redéfinir l’appartenance à l’Amérique.
Nous avons déjà vu ce manuel.
Cette stratégie suit un manuel de jeu américain bien connu. L’acte de 1882 concernant l’exclusion des Chinois a d’abord ciblé les ouvriers, avant de s’étendre pour interdire quasiment toute l’immigration chinoise pendant six décennies. L’internement des Japonais a emprisonné 120 000 personnes— la plupart d’entre eux étant des citoyens américains — uniquement sur la base de leur ascendance.
Les rapatriements mexicains dans les années 1930 a entraîné l’expulsion forcée de plus d’un million de personnes, dont 600 000 citoyens américains. Chaque épisode de ce type a commencé par viser les plus vulnérables, avant de s’élargir progressivement. Tous ont été justifiés au nom de la nécessité ou de la sécurité. Et chacun a créé des précédents dont les effets ont largement dépassé leur cadre initial.
Pour les Haïtiens, ce modèle est particulièrement familier. L’occupation américaine d’Haiti entre 1915-1934 a fait 15 000 morts. Les politiques migratoires envers les « boat people » des années 1980-1990 ont montré que ce ciblage se poursuivait : tandis que les Cubains fuyant le communisme étaient accueillis, les Haïtiens fuyant la dictature étaient interceptés en mer et renvoyés pour faire face à la persécution.
La République dominicaine offre l’exemple contemporain le plus effrayant. En 2013, l’arrêt TC-168-13 a rétroactivement retiré la citoyenneté à toute personne née entre 1929 et 2010 de parents en situation irrégulière, rendant du jour au lendemain plus de 200 000 personnes apatrides. Dix ans plus tard, jusqu’à 130 000 Dominicains restent apatrides, créant une sous-classe exploitable qui profite aux élites tout en maintenant les travailleurs dans une peur constante.
C’est pourquoi la récente décision de la Cour suprême des États-Unis concernant le droit du sol constitue un signal fort pour l’avenir. L’interprétation de la Constitution peut être instrumentalisée pour effacer rétroactivement la citoyenneté – et, avec elle, la dignité humaine.
Fierté sans pouvoir.
En tant qu’Haïtiano-Américains, nous portons fièrement notre drapeau, invoquons notre héritage révolutionnaire et remplissons les festivals culturels. Mais nous sommes rarement présents lorsque des marches, des luttes politiques ou un engagement civique soutenu exigent notre participation. Quand les agents de l’immigration (ICE) font des descentes dans nos quartiers, ces mêmes foules disparaissent.
J’ai beaucoup écrit sur les stratégies d’engagement pour renforcer nos communautés, mais rien de tout cela ne compte sans conscience collective. On ne peut pas bâtir un pouvoir collectif si chacun est en mode survie individuelle.
Je me retrouve souvent en désaccord avec d’autres Haïtiens qui font du néocolonialisme la thèse centrale de tous nos problèmes. Je partage leur lecture du rôle néfaste joué par la communauté internationale dans la crise haïtienne. J’ai lu plusieurs fois Le dernier stade de l’impérialisme de Kwame Nkrumah, et son analyse des tactiques impérialistes reste pertinente. Mais mon désaccord ne porte pas sur leur diagnostic – il porte sur la paralysie qui s’ensuit.
Le livre de Nkrumah a été publié en 1965. Soixante ans plus tard, les Africains et la diaspora au sens large ne peuvent plus se contenter de répéter les mêmes critiques sans faire évoluer notre stratégie. Il faut passer de l’analyse à l’action – une action intelligente, coordonnée et résolument audacieuse.
Où est notre leadership ?
En 2021, j’ai écrit que les leaders haïtiano-américains devaient non seulement se mobiliser, mais aussi s’impliquer, en appelant à un leadership coordonné face à l’urgence du moment. Quatre ans plus tard, alors que le Statut de protection temporaire (TPS) est révoqué et que notre communauté fait face à sa menace la plus grave depuis des décennies, rien n’a fondamentalement changé. D’autres organisations ont tenté de combler le vide, sans réussir à créer la réponse unifiée dont nous avons désespérément besoin.
Le Réseau national des élus haïtiens-américains (NHAEON) est la seule organisation en mesure de jouer le véritable rôle fédérateur dont notre communauté a besoin. Avec des élus à tous les niveaux de gouvernement – des conseils municipaux au Congrès –, NHAEON dispose (ou devrait disposer) de l’infrastructure politique et de la crédibilité nécessaires pour coordonner une réponse globale.
Mais le leadership exige plus qu’une position ; il exige de l’action. Le temps des plaidoyers polis est révolu. Nous avons besoin que le NHAEON assume pleinement son rôle de coordination centrale du pouvoir politique haïtiano-américain.
Le chemin à parcourir ne permet plus la neutralité. Même pour notre propre survie, nous devons nous engager pleinement et intentionnellement. Nous devons donc nous poser quelques questions fondamentales.
Comprenez-vous vraiment l’enjeu ? Il ne s’agit pas seulement d’immigration, mais aussi d’appartenance, de race et de pouvoir. Le statut juridique n’est pas synonyme de sécurité. La citoyenneté ne garantit pas la protection contre des hommes masqués se faisant passer pour des agents de l’ICE. La conscience est le fondement de la résistance.
Qu’êtes vous prêts à sacrifier ? Le changement n’a jamais été confortable. Il nous faudra peut-être renoncer à une part de confort, faire des dons même quand cela nous coûte, ou passer nos soirées en réunions stratégiques plutôt qu’à des événements festifs. La liberté n’est pas gratuite.
Qu’a fait votre fierté pour notre peuple, et êtes-vous prêt à utiliser vos ressources pour vous sauver vous-même ?
Il est temps de transformer la célébration culturelle en pouvoir politique. Avec 4,5 milliards de dollars de transferts annuels, nous disposons d’un levier économique important. Informez-vous et soutenez, par votre argent, votre temps et votre voix, les organisations qui œuvrent pour les droits et la justice des immigrés. Contactez vos représentants. Participez aux réunions du conseil municipal, là où votre voix a un impact immédiat. Soutenez les entreprises appartenant à des immigrés. Investissez dans la capacité de production plutôt que dans la seule consommation. Utilisons notre pouvoir d’achat collectif pour faire pression sur ceux qui nuisent à nos intérêts — à commencer par un désinvestissement en République dominicaine et auprès de ses alliés haïtiens.
Les flammes arrivent.
Aujourd’hui, ils s’en prennent aux Haïtiens titulaires d’un TPS. Demain, ils pourraient cibler les détenteurs de cartes vertes, les citoyens naturalisés, voire leurs enfants nés aux États-Unis. Lorsque des personnes vulnérables sont ciblées, c’est souvent une épreuve. Si personne ne résiste, les attaques s’intensifient et se généralisent.
Comme je l’ai écrit à propos de la rédemption par le pardon, nous ne pouvons plus nous permettre de croire que « Port-au-Prince n’est pas Haïti » — ce même aveuglement sélectif qui nous fait penser que les bénéficiaires du TPS ne sont pas « nous », ou que ce qui arrive aux plus vulnérables ne nous atteindra jamais. Tout comme les gangs se sont étendus de Cité Soleil à Grand Ravine en passant par Village de Dieu, le ciblage s’élargit des immigrants les plus fragiles à ceux qui bénéficient d’une meilleure protection, jusqu’à ce que plus personne ne puisse prendre la parole.
Mon amour pour ma patrie d’adoption ne m’empêche pas de constater que le nationalisme blanc y est profondément enraciné. Je suis reconnaissant de la vie que j’ai construite ici et je crois toujours à la promesse du rêve américain. Mais je ne suis pas naïf, et vous ne devriez pas l’être non plus. La tendance à désigner des boucs émissaires et à exclure n’est pas une exception : c’est une constante.
Il existe un proverbe haïtien : « Lè bab kamarad ou pran dife, fò ou mete pa ou a nan dlo » — quand la barbe de ton voisin brûle, il faut mouiller la tienne. Le feu n’est plus une menace lointaine. Il est déjà dans notre rue, et si nous restons passifs, il atteindra bientôt nos portes. Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre. Il est temps d’agir.
Par : Johnny Celestin
Couverture |Des Haïtiens manifestent à Times Square en réaction aux récents propos du président Trump, jugés méprisants envers Haïti et les pays africains lors d’une réunion sur l’immigration. Source : The Economist
► AyiboPost s’engage à diffuser des informations précises. Si vous repérez une faute ou une erreur quelconque, merci de nous en informer à l’adresse suivante : hey@ayibopost.com
Gardez contact avec AyiboPost via :
► Notre canal Telegram : cliquez ici
►Notre Channel WhatsApp : cliquez ici
►Notre Communauté WhatsApp : cliquez ici



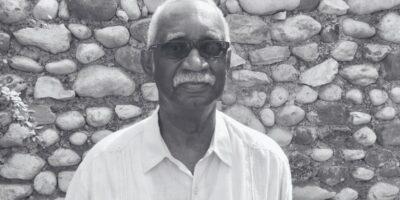



Comments