Pourquoi Haïti a-t-elle signé ? Haïti était isolée, avait besoin de relancer son économie et voulait être reconnue politiquement. Oui, notre indépendance a été reconnue dans le cadre d’un pacte d’indemnité, mais à un coût extrêmement élevé
200 ans après, le Kolektif Ayisyen Afwodesandan (KAAD) appelle la France à participer à la construction d’une autre Éthique dans le monde, plus en harmonie avec l’Idéal Humaniste
Le 1ᵉʳ janvier 1804, Haïti, une ancienne colonie de la France, proclama son indépendance. Cet acte a bouleversé à jamais la géopolitique mondiale, par sa signification historique et politique, ainsi que par l’éthique profonde qu’il affirmait. Ce fut un moment qui a mis en avant la primauté du respect de la dignité humaine et des droits de la personne, autour du principe axiomatique : Tout moun se moun.
Mais le 17 avril 1825 – il y a exactement deux cents ans aujourd’hui – la France a commis une injustice monumentale dont les conséquences se font encore sentir. Sous la menace de navires de guerre, la France a forcé les vainqueurs de l’indépendance haïtienne — les anciens esclaves — à indemniser les perdants : leurs anciens maîtres !
Pourquoi Haïti a-t-elle signé ? Haïti était isolée, avait besoin de relancer son économie et voulait être reconnue politiquement. Oui, notre indépendance a été reconnue dans le cadre d’un pacte d’indemnité, mais à un coût extrêmement élevé – entre 21 et 115 milliards de dollars selon les estimations.
Nous, Haïtiennes et Haïtiens, avons été contraints de payer un montant colossal pour notre liberté. Et lorsque nous n’avons pas pu payer, la France a imposé ses banques pour nous prêter l’argent — c’est pourquoi on parle de double dette. Il nous a fallu plus de cent ans pour rembourser cette rançon !
Lire plus : Opinion | Ce que la France doit à Haïti
La première chose à retenir : La rançon de l’indépendance s’inscrit dans une attitude raciste vis-à-vis d’Haïti. Haïti, née d’une révolution victorieuse d’Africains réduits en esclavage, représentait une menace pour l’ordre mondial suprémaciste blanc. Il fallait stopper la contagion de la liberté des Noirs dans les autres colonies.
La deuxième chose à retenir : La rançon de l’indépendance s’inscrit dans la logique d’un néocolonialisme qui voulait punir, isoler, appauvrir et affaiblir Haïti parce qu’elle avait osé sortir de l’ordre colonial à partir de ses propres forces.
Ce pacte — à peine vingt-et-un ans après l’indépendance du pays — a amorcé la transformation d’Haïti en néo-colonie.
La rançon extorquée a paralysé l’économie haïtienne, affectée tous les aspects de la société et elle est, à beaucoup d’égards, à la base de la crise actuelle en Haïti. Elle a déclenché un cycle d’extraction, d’endettement et de dépendance à l’aide étrangère, aboutissant au sous-développement du pays. Cela a également rendu Haïti instable et vulnérable à la domination des élites et à l’ingérence étrangère. Comment ?
Près de 85 % de la principale source de revenus d’Haïti – les exportations de café – ont été détournés pour payer cette dette monstrueuse.
Il y a exactement deux cents ans aujourd’hui – la France a commis une injustice monumentale dont les conséquences se font encore sentir.
La majeure partie des ressources du pays étaient dédiée au paiement de la rançon. Ainsi, Haïti n’a pas pu investir de manière conséquente dans l’éducation, dans les infrastructures pour la santé et pour la protection de ses citoyens et citoyennes, ni dans des infrastructures pour son développement industriel.
Les conséquences de cette rançon sont actuelles. La crise économique, sociale, politique et humanitaire actuelle en Haïti est profondément liée à l’héritage de l’esclavage, de la colonisation française et de la dette de l’indépendance, qui nous ont privés de la possibilité d’investir dans les moment-clés du développement mondial.
La première source de la gangstérisation en Haïti, c’est la misère chronique, les inégalités sociales accumulées et reproduites depuis deux siècles d’étouffement de notre économie par ce néocolonialisme.
Pourtant, malgré cette dette illégitime et la grave crise qu’elle a engendrée pour Haïti, il faut reconnaître qu’au cours des deux derniers siècles, nous, femmes et hommes haïtiens, avons construit une civilisation haïtienne avec notre propre langue, notre propre religion, nos propres espaces appelés lakou, notre propre littérature, notre propre musique appelée konpa, et notre propre mode de vie. Haïti existe, malgré tout !
17 avril 1825 – 17 avril 2025 : Cela fait 200 ans. Aujourd’hui, nous réclamons Justice et Réparation incluant la réparation financière de la part de la France.
À l’occasion des 200 ans de cette rançon, nous affirmons notre rage contre ce narratif inique et plein de préjugés qui prétend qu’Haïti à trop de problèmes et demeure trop instable, trop faible, pour parler de justice réparatrice. Il est temps de mettre fin à ce discours insidieux. Assez de ce prétexte. C’est honteux !
Nous ne nous tairons pas !
Le bicentenaire de la dette d’indépendance d’Haïti est aussi l’occasion de reconnaître le travail accompli par la société civile haïtienne. La demande de justice réparatrice par Haïti a été menée par la société civile haïtienne, en Haïti comme dans la diaspora, y compris de nombreux intellectuels.
Des personnalités telles que Benoit Joachim, Yanick Lahens, Roody Edme, Gusti-Klara Gaillard, Jean-Marie Théodat, Michèle Duvivier Pierre-Louis avec la Fondation connaissance et liberté – FOKAL, Georges Eddy Lucien avec le Kolektif kont Ranson, Camille Chalmers avec la Plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif (PAPDA), et l’ONG Rakonte Dèt Ranson an, le Groupe de travail de l’Université d’État d’Haïti sur la restitution et les réparations, et bien d’autres encore, ont été à l’avant-garde de la lutte pour la restitution de la « dette d’indépendance » et les réparations pour les torts causés, à travers leurs écrits, leurs recherches, leurs campagnes éducatives et leurs efforts de plaidoyer. Aujourd’hui, nous nous tenons sur leurs épaules, et nous les soutenons. C’est un effort collectif, un continuum qui vise à réparer une injustice historique.
Aujourd’hui, en ce bicentenaire de la rançon, nous appelons la France à saisir cette occasion pour, une fois encore, participer à la construction d’une autre Éthique dans le monde plus en harmonie avec l’Idéal Humaniste. Ainsi, justice serait rendue à Haïti, un pays à qui la justice est due.
1 – Nous appelons la France à reconnaître l’injustice historique commise envers Haïti.
La France doit reconnaître que la justice réparatrice découle de la reconnaissance de l’injustice. Mettons fin à cette amnésie collective. Le peuple haïtien existe et a payé le prix. La justice réparatrice est nécessaire.
2 – Nous appelons les gouvernements de France et d’Haïti à mettre en place une commission binationale composée de ressortissants français et haïtiens, incluant des membres de la société civile, des jeunes, des personnes du secteur agricole et de la diaspora, afin de proposer des actions de justice réparatrice, incluant une restitution financière et des mesures de réparation.
3 – Ensemble, suite à une conversation nationale haïtienne, nous identifierons les secteurs sociaux qui ont le plus besoin d’investissements. L’injustice sociale massive en Haïti montre des besoins criants dans la santé, l’éducation et la culture. Une attention particulière doit être accordée au secteur agricole, qui a porté le plus lourd fardeau, le café ayant été l’une des principales sources des fonds envoyés à la France. La reconstruction de nos institutions et infrastructures est également essentielle.
Le Kolektif Ayisyen Afwodesandan (KAAD) déclare que nous menons une lutte politique, diplomatique et éthique pour une justice réparatrice, en particulier pour la restitution financière et les réparations dues à Haïti, et que nous, Haïtiens, en assurons le leadership.
Nous ne nous contenterons pas de gestes symboliques.
Nous appelons à la solidarité de tous les Afro-descendants dans cette lutte.
Nous appelons à la solidarité de l’Afrique, de l’Asie, de l’Amérique latine, de l’Europe pour cette lutte, qui se situe dans le cadre de l’appel global à la restitution.
C’est un mouvement et c’est un moment.
Et, nous avons besoin d’entendre vos voix ! Nous avons besoin de vous parmi nos alliés !
Il y a urgence. Notre cause est noble, et nous nous battrons jusqu’à obtenir justice.
Restitution maintenant. Réparation maintenant.
Par : Monique Clesca
Porte-parole du Kolektif Ayisyen Afwodesandan (KAAD)
Note : Nous avons appris que le Président de France, M. Emmanuel Macron a, dans un message de l’Élysée, reconnu que l’indemnité était une injustice et a mis sur pied une commission binationale. Les dirigeants haïtiens n’ont pas fait de déclaration en ce jour.
Couverture |En arrière-plan, la façade d’un bâtiment avec le drapeau français. (Source : Canva) À droite, un homme noir, torse nu, les deux mains nouées par des chaînes. (Source : Inconnue) En bas, le drapeau tricolore français. (Source : Canva). Collage Florentz Charles pour AyiboPost
► AyiboPost s’engage à diffuser des informations précises. Si vous repérez une faute ou une erreur quelconque, merci de nous en informer à l’adresse suivante : hey@ayibopost.com
Gardez contact avec AyiboPost via :
► Notre canal Telegram : cliquez ici
► Notre Channel WhatsApp : cliquez ici
► Notre Communauté WhatsApp : cliquez ici



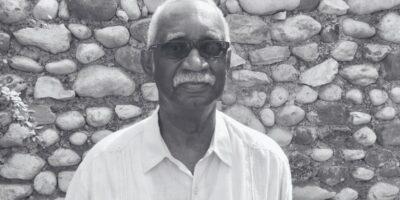



Comments