L’aide au développement n’est pas comparable à l’injustice historique
Dans notre pays, le dicton va : « Ayiti dwe Lafrans, Lafrans dwe Ayiti », comprenez en traduction facile « Haïti doit à la France et la France doit à Haïti ». C’est un dicton dont je ne connais la date d’apparition exacte, mais il a évolué du simple « Ayiti dwe Lafrans » à la forme plus longue que nous connaissons aujourd’hui.
Il remonte à la spirale de la « double dette » que nous avons été contraints de payer à la France de 1825 jusqu’en 1947, même via le rachat de la dette. C’est-à-dire que c’était tellement sur une longue période que la question du paiement de la dette à la France est rentrée dans le langage courant, vernaculaire haïtien pour désigner toute situation de redevabilité et d’insolvabilité envers une autre, pour s’en moquer ou la justifier.
Le dicton inclut certes la version officielle de l’époque des années 1825 à 1915 « Haïti doit la France », mais également le contre-discours populaire, « La France doit Haïti ». Comme un tour de passe-passe. Car le paiement de cette « dette d’indépendance » , quoi qu’il fût accepté par le gouvernement de Jean-Pierre Boyer, avait connu des mouvements de protestation. C’était une décision prise sans l’assentiment de la masse.
Les Français le savent bien. Leur langue est pleine de dictons, d’expressions et de tournures qui ont pour origine des événements marquants, littéraires ou anecdotes historiques. Par exemple, l’expression « revenons à nos moutons » vient d’une farce judiciaire du XVe siècle, La farce de Maître Pathelin, auteur anonyme, écrite vers 1457 à la fin du Moyen Âge.
Car le paiement de cette « dette d’indépendance » , quoi qu’il fût accepté par le gouvernement de Jean-Pierre Boyer, avait connu des mouvements de protestation. C’était une décision prise sans l’assentiment de la masse.
Dans cette pièce, un juge tente de recentrer une affaire de vol de moutons après plusieurs digressions absurdes. Aujourd’hui, l’expression est utilisée dans toute la francophonie (chère à la France) signifiant revenir au sujet principal d’une discussion. Un autre exemple intéressant est « être sur la sellette ». Sous l’Ancien Régime en France, l’accusé était assis sur un petit tabouret appelé « sellette » pendant son interrogatoire devant le tribunal. Aujourd’hui cela veut dire « être soumis à un jugement, à des critiques ».
Donc, revenons à nos moutons : quand un événement passe du stade factuel à l’imaginaire collectif, il prend une importance symbolique qui dépasse la réalité historique : il devient un repère, une leçon, un mythe ou un avertissement, mobilisé dans le langage, les références communes et même l’identité collective.
C’est ainsi que la double dette est rentrée dans l’imaginaire collectif haïtien avec le dicton « Ayiti dwe Lafrans, Lafrans dwe Ayiti ». Mais sans vouloir mettre la France sur la sellette, il est important, qu’en toute sincérité, nous puissions vous dire, amis Français, ce que la France doit à Haïti et qu’Haïti ne doit pas à la France. Ici quand nous disons la France pour parler de la dette, nous parlons de l’État français, l’institution, pas le pays et ses paysages époustouflants.
Demander à la France de reconnaître ce qu’elle doit à Haïti n’est pas anti-Français
Que cela soit clair : aimer la langue française, apprécier les écrits de Honoré de Balzac, Victor Hugo, les poèmes de Baudelaire, les réflexions de Sartre ou de Frantz Fanon, reconnaître la beauté de Notre-Dame, ou encore savourer les écrits de Simone de Beauvoir ; siroter du Beaujolais Nouveau tous les ans ou déguster du fromage français ne remet pas en question mon haïtianité, ni mon amour pour la langue haïtienne, le créole.
Ici quand nous disons la France pour parler de la dette, nous parlons de l’État français, l’institution, pas le pays et ses paysages époustouflants.
Je ne donnerais pas mon lalo pour un camembert, cela s’entend. Nous pouvons objectivement reconnaître la beauté de la France sans s’aliéner. Nous aimons les Guadeloupéens autant que les Martiniquais ou les Guyanais, ou des autres territoires et départements d’outremer – pour des raisons historiques et géographiques que nous connaissons tous, mais l’État français reste l’État français avec tout ce qu’il a organisé ou parrainé dans le monde. Qu’ils soient à Saint-Pierre-et-Miquelon dans le nord canadien (n’en déplaise à celui qui pense que c’est un territoire pour les OQTF), ou à l’île de la Réunion dans l’océan indien, à moins qu’ils n’en décident autrement.
Quel que soit notre amour pour nos frères antillais, demander à la France de réparer un tort envers les Haïtiens ne sous-entend pas que tous les Haïtiens sont anti-Français, ni anti-Antillais.
C’est une invitation à la France d’être autant objective que nous pouvons l’être à son égard. C’est entamer une réconciliation avec son passé avec Haïti et non une aliénation de ce passé. Il faut admettre la violence de ce passé pour se réconcilier avec les descendants de celleux assujettis à cette violence. C’est une démarche reconstructive. Et pour la mener à bien, il nous faut une reconnaissance, « sur les ressources d’une ouverture autoréflexive et intersubjective » comme l’a souligné Jean Marc-Ferry ; procéduralement parlant, « dans la dialectique reconstructive, la reconnaissance réciproque est reconnaissance de violence réciproque et demande de réconciliation.»
Lire plus : Ce que les Français doivent vraiment à Haïti
Reconnaître le tort causé à l’autre est un dépassement qui peut témoigner ce que la France reconnaît dans ses veines : une nation qui défend les droits humains et la justice. La France est, dans les signes du temps, un pays qui veut garder sa ligne, malgré ses errements en Afrique, pour signifier l’inaliénabilité des droits humains, montrer que la vie humaine subsume notre perception de sa violence, sa pauvreté ou sa couleur de peau.
La France peut rester objective, dans le sens de Raymond Aron – objectivité ne signifie pas impartialité mais universalité. Accepter et reconnaître le tort causé à Haïti en l’ayant forcé de payer une « dette de l’indépendance » rentre dans cette lignée. Ça, la France le doit à Haïti.
Car se battre pour sa liberté était la meilleure leçon d’universalité des droits humains que les Français revendiquaient sans son essence universelle en 1789.
Haïti a combattu pour une liberté universelle.
La dette de la France envers Haïti n’est pas que morale
Demander de reconnaître l’injustice faite à Haïti, deux cents ans plus tard, est inviter la France à reconnaître qu’entre amis, les torts doivent être reconnus et les promesses tenues. « La dette morale » dont a parlée François Hollande le 13 mai 2015 n’est pas que « morale ».
Dix ans plus tard, Emmanuel Macron, le président français, suivra-t-il la voix du peuple français à travers son Assemblée nationale ? La Proposition de résolution visant à la reconnaissance, au remboursement et à la réparation par la France de la « double dette » d’Haïti déposée à l’Assemblée nationale de France le mercredi 9 avril 2025 est un pas vers cette France réellement protectrice des droits humains. Une proposition qui reconnaît que la dette n’est pas que morale, et qu’Haïti a droit à une juste réparation et une restitution. Nous applaudissons l’adoption de cette résolution et attendons les actes concrets du gouvernement français.
Passer plus d’une centaine d’années à taxer une population paysanne, à payer des anciens colons, et des banquiers a certainement contribué au sous-développement d’Haïti. Les États-Unis ont accepté de payer 15 millions de dollars à la France en 1803 (soit 80 millions de francs) pour l’achat de la Louisiane qui à l’époque était un territoire de 2 145 000 kilomètres carrés de terres à l’ouest du Mississippi, du Mississippi aux Rocheuses et du golfe du Mexique à la frontière canadienne.
Vingt-deux ans plus tard, cette même France a exigé 150 millions de francs or à un petit pays de 27,750 kilomètres carrés pour s’être battu pour son indépendance et vouloir commercer avec le monde. Il y a-t-il matière à débat sur cette injustice et ses conséquences ?
Pendant plus de cent ans, des investissements dans des infrastructures ont été mis de côté parce qu’il fallait payer cette rançon. Jusqu’au moment où l’on parle, des millions d’Haïtiens n’ont pas accès à l’eau (et déjà c’est une chance s’ils ont accès à l’eau potable avec robinets), à des services de santé, d’éducation, de nourriture, de logement, et des infrastructures modernes. Pas besoin d’artifices ni de circonvolutions, d’expressions charitables pour le reconnaître.
Entamer une nouvelle page de sincérité dans les relations franco-haïtiennes
Est-ce que les enfants d’Haïti ont aussi contribué à son embourbement, tel que nous le vivons aujourd’hui, oui. Mais est-ce que les causes qui précèdent cette chute incluent la responsabilité de notre ami français, certainement. L’engagement pour aider ce pays à se relever, ça, la France le doit à Haïti.
La coopération française soutient des efforts dans le pays dans divers domaines dont la culture, l’éducation, et un petit appui à la sécurité (les communicants de l’Ambassade de France vont probablement nous éclairer à ce sujet). J’apprécie grandement l’engagement de l’Agence française de Développement (AFD) sur le terrain. Mais cela n’efface pas ce que la France doit à Haïti.
L’engagement de l’AFD mérite une plus grande enveloppe pour le développement des infrastructures, le renforcement de la sécurité, l’éducation et la santé. L’aide au développement n’est pas comparable à l’injustice historique.
Défendre la sincérité entre nations, c’est parier sur une diplomatie éthique, fondée sur la parole tenue et la confiance réciproque. Certains penseurs français, comme Pierre Mendès France dans les années 1950, ont incarné une tradition de franchise diplomatique. Nous invitons la France à faire ce pas envers Haïti. L’État français a tout de même une grande responsabilité envers ce petit pays des Caraïbes.
Défendre la sincérité entre nations, c’est parier sur une diplomatie éthique, fondée sur la parole tenue et la confiance réciproque.
Si entre 1825 et 1947, le dicton avait un sens pour « débiteur et créancier » , en 2025, deux cents ans après, c’est surtout le « créancier » qui doit comprendre : Lafrans dwe Ayiti, men Ayiti pa t dwe Lafrans. Il faut donc le reconnaitre, et agir en conséquence. La balle est dans le camp de l’État français.
Par : Yvens Rumbold
Couverture | Portrait du président français Emmanuel Macron à gauche. ( Source : lavenir.net) Photo d’un homme tenant le drapeau haïtien en arrière-plan. ( Source : FranceInfo ) Image du drapeau français en bas. ( Source : Freepik )
► AyiboPost s’engage à diffuser des informations précises. Si vous repérez une faute ou une erreur quelconque, merci de nous en informer à l’adresse suivante : hey@ayibopost.com
Gardez contact avec AyiboPost via :
► Notre canal Telegram : cliquez ici
► Notre Channel WhatsApp : cliquez ici
► Notre Communauté WhatsApp : cliquez ici





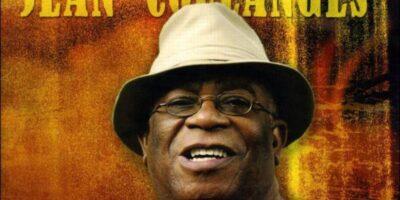

Comments