L’expression « tout moun se moun » voudrait donc dire : « tout humain est un humain », sous-entendu : ils doivent tous être traités de la même façon. Par conséquent, les Temps Modernes font fausse route au départ même de l’aventure impériale parce qu’ils ne saisissent pas que l’égalité foncière de ceux qui intègrent la force de travail est compatible avec la diversité de leurs conditions de travail
L’historiographie raconte du passé d’Haïti un récit, élaboré surtout à partir de documents sélectionnés dans les archives de puissances mises en déroute lors de la guerre de l’indépendance : la France, l’Angleterre et l’Espagne. Elle colporte les absences et les obscurités de la mémoire de ces puissances. Il convient de corriger leur projet en utilisant notre mémoire à nous.
Le pillage des bandits-conquistadors au XVIe siècle, la mainmise systématique des biens produits par les engagés et captifs aux XVIIe et XVIIIe s’accumulent et renforcent la puissance de l’État qui, de la sorte, se distance des dominés appauvris par des inégalités de plus en plus insurmontables.
En fin de parcours, les opérateurs de l’État et des compagnies commerciales acquièrent une liberté d’action que les institutions promotrices de telles inégalités ne peuvent plus contrôler.
On arrive à cette veille d’apocalypse parce qu’au départ, les chercheurs, fascinés par les faits et gestes du monde moderne, ne se rendent pas compte que celui-ci réduit systématiquement au silence, la portée des actions réalisées par les populations exploitées. On s’imagine dans une impasse, car ces actions sont les seules qui anticipent et résolvent ses méfaits. L’incapacité des dominants d’héberger une altérité quelconque paralyse leur audience. La diversité de l’autre se noie dans une sorte d’universel qui banalise tout défi susceptible de dépasser le quotidien et d’expliquer la menace d’implosion toujours imminente.
Dans le cas des Haïtiens, après le génocide entrepris par les bandits-conquistadors, trois groupes de damnés de la terre remplacent la première nation : les rejets des côtes occidentales de l’Europe, vaguement unis par un féodalisme en mutation, les serviteurs engagés qui s’ajoutent à eux et la pléthore de captifs séquestrés dans le golfe de Guinée.
Les récits historiques enregistrent l’existence de ces êtres vulnérables, en décrivant la violence continue que mettent en œuvre l’État et ses institutions pour assurer leur conformité à ses projets. La banalisation de cette violence et des souffrances qu’elle cause dispense les archives de l’État du besoin de les consigner.
Ainsi la connaissance, toujours nouvelle, des peines causées modifie à peine l’itinéraire des puissances établies. De cet angle, l’on découvre les liens qui subordonnent Haïti aux empires coloniaux.
Les deux faces de la colonie
Si, en revanche, l’on recherche ce qui unit les Haïtiens entre eux, on avance dans un champ qui exige des empires coloniaux l’utilisation sans désemparer d’une violence crue. La brutalité est essentielle, au départ, à leurs rapports avec les habitants de l’île, marginaux par définition.
Ceux qui choisissent de vivre à l’île de la Tortue — pirates et voleurs de grands chemins, ainsi que huguenots, juifs et maures — sont vite débordés par les déportations de vagabonds et de sans aveu, forcés de s’intégrer aux plantations de denrées. À ces pauvres hères, s’ajoutent les engagés qui se vendent comme esclaves de 36 mois pour payer leur passage.
En s’exerçant à survivre, cet ensemble de malheureux produit une variété de la langue antillaise, distincte du parisien et apparentée aux parlers des provinces d’où ils sont originaires. Leur langage particulier reflète la divergence entre leur réalité de subordonnés et celle où se déplace la cour du roi, départ dû à leur isolement et aux discriminations sociales et religieuses imposées à leur quotidien. Leur usage du créole témoigne de leur autonomie.
Les fonctionnaires de l’empire ne réalisent pas que le rôle joué par le créole dans ce microcosme dépasse les fonctions de gestion administrative dévolues au français parisien, et précède son irruption dans le milieu. La préséance de la langue royale lui vient de son pouvoir, non de sa sophistication, de son ancienneté ou de sa généralisation dans cette géographie.
Les harassements de l’Inquisition espagnole conduisent les émigrés de Saint-Domingue à demander protection aux autorités parisiennes, qui y dépêchent les puissantes Compagnies commerciales mercantilistes. Celles-ci promeuvent l’implantation de riches planteurs et commerçants des villes portuaires, dont la maîtrise du francien est indiscutable. Toutefois, cette insertion n’ébranle pas l’hégémonie de la langue locale, comme l’établit l’historien, journaliste et diplomate Jean Fouchard en se référant aux parlers des « marrons ». Leur usage des langues provinciales indique le poids dans la vie quotidienne des petits planteurs et des « petits-blancs », et leur portée dans la structuration de la langue créole.
À cette diversité entre des couches sociales de souche européenne, s’ajoutent des fractures ethniques qu’obscurcit la perception de la majorité restante comme une masse indifférenciée de Noirs. Vers l’année 1700, les deux tiers de la population viennent du golfe de Guinée, proportion qui atteint les 90% sur la fin du siècle. Le pays croit avoir reçu 21 ethnies différentes, parmi lesquelles on peut compter les Nagos, les Ashantis, les Ibos, les Wolofs, les Bambaras, les Haoussas, les Kongos, les Mandingues.
L’adoption nécessaire du créole par ces êtres à enterrer socialement demande de distinguer les rapports sociaux internes de la colonie, des relations politiques de cette entité avec sa métropole. Les captifs sont soumis à des fossoyeurs, eux-mêmes exploités par l’empire.
On observe, d’entrée de jeu, que l’histoire de l’État colonial et de l’État d’Haïti peut emprunter le chemin que signalent les archives traditionnelles et arriver au contrat politique que le premier impose au second. Celle des Haïtiens accuse un itinéraire dont la source peut couler en direction opposée. Une analyse de données qui privilégie le sac des richesses locales, y compris l’exploitation à outrance de la force de travail, ne peut que conduire à un tableau impérial, et éviter l’émergence d’une formation souveraine.
En sens contraire, une analyse de l’histoire des Haïtiens, c’est-à-dire de leur quête incessante de souveraineté, enregistre l’érosion permanente de toute subordination à l’État et à l’empire.
Le contrat social nécessaire : Tout moun se moun
En débarquant, les Guinéens parlent une variété d’idiomes ouest-africains. Par leur vertigineuse multiplication, ils finissent par s’approprier la langue usuelle, et par s’inscrire dans la société coloniale. Des pratiques que cette majorité tisse avec ceux qui l’entourent, émerge le socle de valeurs d’une pensée caractéristique des locuteurs de cette langue et, partant, des classes qui la parlent.
Dans le tome V de son Histoire d’Haiti, Thomas Madiou a observé ce qui suit : « Les masses étant noires et jouissant de tous les droits civils et politiques, gagnaient du terrain de toutes parts, et avec elles leurs mœurs, qui étaient au fond guinéennes, prenaient racine. Les sang-mêlés, qui formaient un dixième de la population l’un dans l’autre, étaient en grand nombre presque identiques aux noirs à l’égard des mœurs, des habitudes et des inspirations (…) ».
Cette multiplicité d’ethnies devient une nation américaine par suite de conditions d’exploitation au-delà de l’humainement supportables. Elles traversent l’Atlantique en unités individuelles dénuées de tout. Fragiles, ces personnes n’amenuisent leur vulnérabilité que par leur solidarité et leur réciprocité avec leurs compagnons d’infortune. Pour retarder leur trépas, elles recourent à leurs plus élémentaires dénominateurs communs, et construisent de nouvelles communautés, donc de nouvelles individualités, susceptibles de tourner le dos aux définitions clefs du système de plantations et de les dépasser.
En cheminant ce Golgotha, ces personnes accentuent les différences de la langue usuelle d’avec la dominante, y ajoutent une relexification qui traduit leurs expériences, ainsi qu’une syntaxe et une sémantique proches des langues Ouest-africaines.
De plus, elles imposent un choix de catégories qui réorganisent leur réalité et dont l’inventaire est encore à faire. On peut citer d’importants acteurs d’un récit débité en français qui sont inconcevables en créole : les anciens libres, les nouveaux libres et l’armée indigène sont des cas patents.
Contrairement aux émigrés d’origine européenne, le contenu de la langue des captifs ne coïncide pas avec les idées et les valeurs qui ordonnent la vie à la cour des rois de France et celle de ses serviteurs. Un inventaire de la langue locale permettrait de dessiner l’architecture du monde des opprimés. La cour royale et la métropole ont leurs archives « formelles » qui s’organisent à partir de leur velléité de régenter l’univers et l’humanité tout entière. Ce vœu pieux ne se réalise pas encore, comme l’existence même du créole en témoigne.
Dans la langue usuelle, les captifs nient catégoriquement entre eux qu’ils n’aient jamais été esclaves, même si leurs conditions de vie sont fixées par des institutions esclavagistes. La perception et le rejet de l’injustice de leur situation sont pérennes. Leur monde en formation ne permet pas de déterminer les dates de l’élimination de l’une ou l’autre proposition du monde dominant, mais certains jalons sont visibles. Le contrat social liminaire qui unit les Haïtiens est stipulé dès la Constitution de 1801 de Toussaint Louverture. On y lit à l’Article 3 : « Il ne peut exister d’esclaves sur ce territoire, la servitude y est à jamais abolie. Tous les hommes y naissent, vivent et meurent libres et Français ».
Observer les hauts faits de la révolution haïtienne comme la seule révolution d’esclaves à avoir eu du succès, c’est emprisonner celle-ci dans l’histoire d’une pensée propre aux Temps Modernes et se refuser à saisir le processus contestataire mis en marche dès leur arrivée. La société dominante s’emmure dans l’impensable. Elle sait que des êtres socialement morts ne peuvent pas se rebeller ; pour le faire, il faut être « socialement bien en vie ».
La question pendante est donc de savoir comment ces agrégats de miséreux s’inventent une vie sociale propre, c’est-à-dire comment nouent-ils un contrat social, et se convertissent-ils en une nation. Comment se démarquent-ils des conquistadors tout-puissants, en formant une communauté agissante et contestataire ?
L’expression « tout moun se moun » s’utilise pour nier toute différence significative entre les personnes, considérées individuellement. En créole, il est pour le moins absurde de penser que le noble soit essentiellement supérieur au vilain. Ce principe, hérité du féodalisme, répugne à la pensée haïtienne. En revanche, pour les oligarchies de l’heure, la racaille de leurs pays — ces « gens du dernier néant » (Charles Frostin) –, de même que les Noirs, leur seraient, par définition, inférieurs.
Dans les lubies de ces oligarchies, les mots « tout moun » traduiraient une déformation de l’expression française « tout le monde ». Or l’emphase que produit la redondance jure avec le français de la cour royale et il semble clair que l’expression ne peut dériver de cette source, malgré l’évidente similitude de leur assonance. La redondance nie, non pas l’altérité entre les individus, mais toute hiérarchisation de cette altérité.
Les gens du golfe de Guinée, forcées de s’établir en Haïti, sont des bantous. Ce vocable veut dire « humain », et il fait « mountou » au singulier. L’expression « tout moun se moun » voudrait donc dire : « tout humain est un humain », sous-entendu : ils doivent tous être traités de la même façon. Par conséquent, les Temps Modernes font fausse route au départ même de l’aventure impériale parce qu’ils ne saisissent pas que l’égalité foncière de ceux qui intègrent la force de travail est compatible avec la diversité de leurs conditions de travail.
Il convient d’éliminer une autre confusion. « Tou » en créole haïtien ne se traduit pas par « tout » en français, avec deux lettres « t ». En créole, il n’y a pas de lettres muettes et les deux mots se prononcent certes de la même façon. Le « tou » (sans le t final) veut dire « aussi ». À un affront quelconque, un Haïtien se défend en disant : « mwen se moun tou », pour exprimer qu’il est une personne et que nul ne peut lui manquer d’égard. Il ne veut pas dire : « Je suis un monde, aussi ».
Toujours dans la même veine et pour emphatiser l’égalité de tous les bantous ou humains, dans notre expérience d’opprimés, l’altérité de l’autre devient superficielle. La phrase « nou se menm nou menm nan » est une autre redondance dénuée de sens en langue impériale. Elle veut dire que « vous êtes simplement nous-mêmes », mais comme dans le « tout moun se moun », nous charrions l’élimination du « vous autres », nous disons mot à mot : « Nous sommes les mêmes nous-mêmes ». C’est-à-dire que nos dénominateurs communs sont de loin plus importants que nos différences.
Aussi, dans la profonde crise que traverse de nos jours l’État haïtien qui se trouve dans l’impossibilité de contrôler le siège de sa bureaucratie et les rapports de sa ville primate avec les provinces, si des bandits pénètrent dans votre domicile et menacent d’exterminer toute votre maisonnée, s’ils vous en laissent le temps, vous leur demanderez : « Pou ki sa n ap touye nou ? ». Traduit mot à mot, vous direz : « Pourquoi nous nous tuons ? ».
Tout semble donc indiquer que, dans la confrontation avec les conquistadors-bandits, nous sommes arrivés à éliminer le « vous autres » de notre conversation. En faisant abstraction de la deuxième personne du pluriel, est-ce que nous prenons acte du fait qu’il est impossible de communiquer avec les « nobles », dans la mesure où ils se considèrent comme tels ? Le créole haïtien reconnaît-il qu’il existe des gens qui, de leur lieu d’énonciation, ne peuvent simplement pas nous comprendre, et vice versa ? Car cette égalité foncière est un vécu quotidien, et non une valeur à atteindre dans un paradis ultra-terrestre, et dont l’existence prétendument certaine n’empêcherait pas d’accepter, les diktats de la raison instrumentale.
Du coup, tout en manipulant le concept de race, essentiel à l’implantation de la modernité occidentale qui nous assiège, il nous demeure étranger. Le conquistador des nouvelles crues, ne pouvant le fonder rationnellement, nous l’impose par la violence. Il en est de même du concept de classe, même si la violence qui le sous-tend s’enrobe d’un meilleur déguisement. Ces concepts déterminent nos conditions de vie, mais de telles conditions ne nous définissent pas, et ne définissent pas les paramètres de notre existence. Elles demeurent extérieures à notre réalité où « tout moun se moun ».
Dignité et précarité
De toute évidence, le peuple haïtien vit dans une pauvreté effarante. Il réalise tout ce qui est en son pouvoir pour sauvegarder le respect et la dignité qui le définit durant les pires moments de l’histoire. Les communautés sont responsables de leurs membres et réciproquement, ceux-ci répondent d’elles. Tous respectent les anciens et les invisibles, discutent et résolvent leurs problèmes dans la langue qu’ils leur ont léguée.
La commotion actuelle vient de notre irruption, tout anarchique, dans la vie publique. Cette arrivée inopinée saccage le siège que l’Occupation américaine se prépare depuis 1915. En nous imposant ses politiques de type Jim Crow que couronnent les programmes d’ajustement structurel, ils détruisent notre confinement. Bon gré mal gré, nous envahissons la capitale qu’elle s’est construite. Comme elle ne comprend pas encore ce que veut dire Tout moun se moun, elle a les deux pieds dans un seul soulier ; tandis que nous sommes en train de trépasser sans pouvoir saisir pourquoi nous nous tuons.
Par : Jean Casimir
Couverture | Quelque 200.000 Haïtiens, principalement à Port-au-Prince (photo), ont été contraints par l’insécurité de se réfugier dans des lieux temporaires. Source : Nations Unies
► AyiboPost s’engage à diffuser des informations précises. Si vous repérez une faute ou une erreur quelconque, merci de nous en informer à l’adresse suivante : hey@ayibopost.com
Gardez contact avec AyiboPost via :
► Notre canal Telegram : cliquez ici
►Notre Channel WhatsApp : cliquez ici
►Notre Communauté WhatsApp : cliquez ici

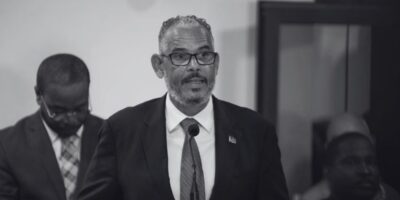



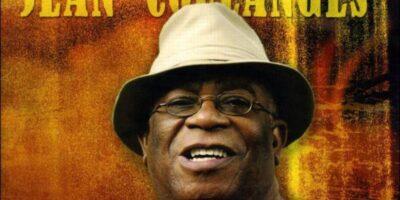

Comments