La décolonisation est un impératif, selon le sociologue Jean Casimir
Hier, 18 novembre 2020 marquait les 217 ans de la bataille de Vertières. C’est l’étape finale dans la lutte menant à la révolution haïtienne de 1804. Cette révolution offre une clé pour la compréhension géopolitique de l’Amérique latine ; de la genèse de ses États-nations à son incommensurable actualité.
En raison de l’importance de ce fait historique, sa lecture et son analyse ne peuvent avoir lieu ni depuis une vision opaque ni depuis des regards borgnes. Connaître ce processus exige une analyse critique et une lucidité profonde.
En ce sens, penser Haïti du point de vue du sociologue Jean Casimir permet non seulement d’enquêter sur des concepts jusqu’à présent oubliés, mais également une lecture décoloniale de l’histoire haïtienne.
Pour commencer, il est important de préciser ce qu’il faut entendre par « pensée décoloniale ».
Parler de décolonialité aujourd’hui renvoie à différentes dimensions, tant académiques que politico-sociales. La pensée décoloniale reprend à son compte des concepts tels que la modernité, l’eurocentrisme, le capital, le travail et la race « en tant que catégorie mentale » pour nommer et rendre visible le fait que les relations coloniales continuent d’exister malgré la fin des colonies.

Le pari des penseurs décoloniaux est important parce qu’il explicite la dimension eurocentrée de notre imagination. Il ne s’agit pas seulement de qualifier les choses d’« eurocentré » ou de « colonial », mais bien d’interroger ce courant de pensée voulant faire croire qu’il n’y a pas d’autre façon de penser et visant à nier ainsi la connaissance autre, les autres expériences et la manière de comprendre le monde en dehors des paramètres établis à partir de 1492.
Afin de mesurer l’importance de cette pensée, il faut se rappeler que jusqu’à récemment, la dynamique latino-américaine jouait à « l’indépendance », alors qu’en interne la manière « d’être » et le « savoir » perdaient leur place sur ces territoires. Les récits de ces peuples sont faits « d’histoires pour petits-garçons et petites-filles » et ne sont pas considérés comme du « savoir ». Ils ont partout cessé de parler leurs propres langues pour adorer la langue coloniale. Ce n’est pas un hasard si environ 420 langues différentes sont parlées en Amérique latine et que la majeure partie des jeunes sont incapables d’en citer dix.
La pensée décoloniale permet de connaître « l’histoire silencieuse », de créer de nouveaux récits qui donnent un sens à ces territoires et aux souvenirs de leurs habitants. Il s’agit de penser la réalité à une échelle dépassant les dichotomies. Pour cet exercice ontologique, le regard du sociologue Jean Casimir permet de se plonger dans la complexité des réflexions locales.
Concernant Haïti, deux grands pôles narratifs peuvent être identifiés. Le premier porte sur la vie quotidienne à l’intérieur du pays qui se réduit à de brèves histoires d’ouragans, de tremblements de terre et d’interventions militaires comme celles des Français, des Américains ou des récentes missions des Nations Unies. Et le second psalmodie l’Haïti de Dessalines, d’Henry Christophe, de Pétion.
Penser Haïti selon le point de vue de Jean Casimir permet de sortir de cette dichotomie et, comme il le souligne lui-même, « d’écouter ce que dit le peuple haïtien ».
L’itinéraire du peuple souverain d’Haïti
Ils sont nombreux les auteurs qui ont retracé l’histoire de la guerre de l’indépendance nationale (l’exploit des héros) ainsi que l’impact de cette révolution sur le reste du monde.
Mais comment « le peuple souverain d’Haïti » ayant vu le jour dans un contexte esclavagiste, colonialiste lui privant de toute son humanité, a su recréer sa vie ? Cette question fondamentale a très peu attiré l’attention des spécialistes en sciences humaines et sociales haïtiennes. Jean Casimir en a fait le creuset de ses différents travaux depuis plusieurs décennies. Dans cet article, nous nous intéressons à un de ses ouvrages, publié en 2018, dans lequel il développe la sociogenèse de la population rurale haïtienne.
Comment les « nouveaux-haïtiens », composés de deux tiers de gens nés en Afrique à la veille de la révolution, qui ont été désocialisés, déshumanisés, décivilisés (Jean-Claude Meillassoux) via la machine infernale du système esclavagiste occidentale moderne, vont « se réinventer » ? C’est-à-dire tisser des liens sociaux solidaires, fonder une famille, se nourrir, se divertir, développer leur spiritualité et créer des structures autonomes d’autogestion. Comment vont-ils habiter le monde du 19e siècle qui a pour fondement le colonialisme, le capitalisme et le racisme ?
C’est ce que nous propose Jean Casimir dans son ouvrage : Une lecture décoloniale de l’histoire des Haïtiens. Du traité de Ryswick à l’occupation américaine (1697-1915). Ce n’est ni l’histoire des héros de la guerre de l’indépendance nationale, ni celle de la trajectoire de l’État haïtien, mais plutôt l’itinéraire des masses populaires.
Sa démarche vise à saisir les mécanismes mis en place par les « anciens captifs africains devenus haïtiens » en vue de faire face à l’oppression du monde qui l’entoure à travers la création d’un système de Contre-Plantation.
Le lieu d’énonciation de Jean Casimir
Il y a au moins deux perspectives qui s’imposent dans la manière dont on peut appréhender l’histoire d’Haïti. Soit on se place aux côtés de Christophe Colomb à bord des trois caravelles ; soit on se retrouve sur la plage en compagnie des Taïnos voyant arriver sur leur territoire les envahisseurs européens.

Taino
Pour la première, l’île d’Haïti serait une découverte, une conquête. Ce qui obligerait les colons à la renommer Hispaniola. Et les gens qui y habitent seraient des Indiens, des barbares que les européens ont pour mission d’inculquer les vertus de la civilisation. Le tout passe par la conversion au christianisme et le fouet.
La deuxième perspective, dans laquelle s’inscrit Jean Casimir, considère l’invasion européenne comme une catastrophe occasionnant l’extermination de tout un peuple. De ce fait, les Indiens, les Noirs qui sont des expédients du discours européen, constituent des catégories créées dans l’objectif de répondre aux visées coloniales et esclavagistes des envahisseurs. Partant de ce lieu, les nations africaines kidnappées et déportées dans la colonie ne seront plus des Noirs, mais plutôt des Congo, yoruba, ashanti, Dahomey, etc… Pour les premiers peuples de l’île d’Haïti considérés comme des Indiens dans l’historiographie coloniale, ils seront des tainos.
En substance, c’est le lieu d’énonciation (l’acte de dire) qui va déterminer ce qu’on voit. « Si nou pa chita sou menm bit, nou pa ka wè laplenn menm jan », pour paraphraser Frankétienne.
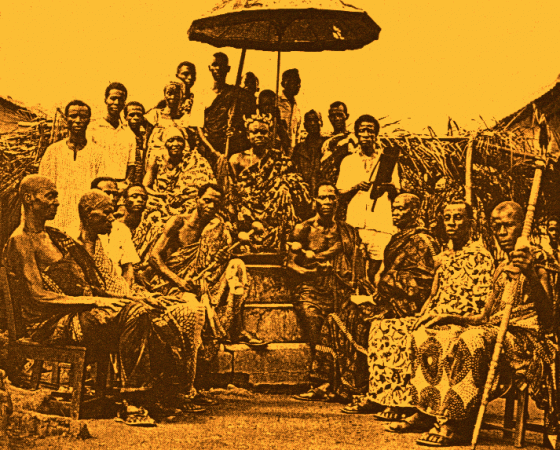
Communauté d’Ashanti
« On ne naît pas haïtien, on le devient »
Pendant la colonisation, la main-d’œuvre coloniale se reproduit sur le marché. À la veille de la révolte de 1791, les deux tiers de captifs composant les ouvriers coloniaux sont nés en Afrique. Ils sont arrivés deux décennies avant dans les plantations. La révolte qui a suivi le congrès de Bois Caïman a freiné leur processus de créolisation. Ils ont connu à peine l’enfer de Saint-Domingue contrairement aux affranchis de vieille souche qui sont nés dans la colonie.

Cérémonie du Bois Caïman

Plantation de canne-à-sucre dans la colonie
Ce sont des étrangers qui ont donné naissance à la nation haïtienne.
L’ingénierie coloniale n’a pas pu transformer en esclaves (des êtres soumis) les captifs africains (les bossales). Les colons n’ont pas pu extirper dans l’âme de ces adultes leur vie antérieure, celle qu’ils ont connue en Afrique. Ce sont eux qui vont constituer les deux tiers de la population haïtienne. En d’autres termes, ce sont des étrangers qui ont donné naissance à la nation haïtienne.
À travers un processus de transculturation, ces étrangers ont su développer des outils pour se protéger des atrocités du système esclavagiste. Ils ont appris à se connaître les uns les autres, mettant de côté les différences ethniques qu’ils avaient auparavant. D’où l’émergence des chaînes de solidarité depuis l’habitation coloniale jusque dans les communautés de marrons (les doko) après leur fuite. Au fur et à mesure, durant les 14 années de la guerre de l’Indépendance, les bossales s’indigénisent pour devenir les Haïtiens, à la fin. Ils vont mettre en branle un système de Contre-plantation.

Le marron Mackandal sur une ancienne pièce de monnaie
Des « places à vivre » à la contre-plantation
Dans l’enfer des habitations coloniales, les maîtres vont céder aux « esclaves/captifs » des lopins de terre pouvant leur permettre de se reproduire.
À partir de là, ces ouvriers coloniaux vont apprendre au moins deux choses : le goût de travailler pour soi et la nécessité de s’entraider. D’où l’émergence des velléités d’autonomie, des relations réciproques solidaires. Le marronnage va renforcer toute cette dynamique et élargir sa sphère d’influence.

Bien avant la proclamation officielle de l’indépendance nationale, les anciens captifs expérimentent déjà des initiatives souveraines et autonomes. Voilà ce qui explique en partie toute la difficulté qu’allaient avoir les élites autoproclamées Haïtiennes au lendemain de 1804, de relancer le modèle économique de grande plantation.
Après la révolution, les nouveaux oligarques qui remplaçaient les colons français avaient la terre (principal moyen de production), l’appareil répressif (l’armée indigène), l’administration publique, mais pas de main-d’œuvre. Car la grande majorité constituant la population haïtienne optait pour la contre-plantation qui est un modèle économique charriant un ensemble d’institutions aux antipodes du projet colonial.
La contre-plantation : ses caractéristiques, son succès
Après 1804, le système de contre-plantation s’est mis en place de manière autonome. Inspiré des modes de vie d’anciennes nations africaines, il va se développer dans le milieu rural haïtien à travers le « lakou » qui est l’unité sociale de base. À cela s’ajoutent « la propriété familiale indivise, la langue créole, les formes de spiritualité encapsulées dans le vaudou, le calendrier et le rythme de la vie communautaire ». Sa reproduction est assurée par des petites plantations autonomes dont l’objectif est de subvenir aux besoins internes du pays. Les marchés ruraux ainsi que les bourgs-jardins servent d’intermédiaire entre les différentes communautés.
Pendant une trentaine d’années de stabilité politique, le système de contre-plantation « accuse des niveaux de bien-être supérieurs à ceux de la région caribéenne ». L’historien haïtien Leslie F. Manigat parlait même de « bonheur vivrier » en analysant le monde rural haïtien du 19e siècle.
Tout cela traduit le succès du modèle économique contreplantationnaire s’opposant farouchement à la grande plantation qui est un héritage de la colonisation. Ce modèle économique extraverti a pour fondement le rapport « maître-esclave » dans la dynamique sociopolitique d’avant 1804. Au cours de la période postrévolutionnaire, il va mettre l’emphase sur le couple « grand propriétaire/cultivateur ou citoyen attaché à la terre » suivant les prescrits juridiques de l’État postcolonial.

Les tenants du système de plantation embrassent une vision du monde dans laquelle l’haïtien est perçu comme francophone, chrétien, issu d’une famille nucléaire. En opposition, le modèle de Contre-Plantation propose un haïtien créolophone, vodouisant appartenant à une famille étendue et une société-villageoise caractérisée par des rapports de réciprocité, solidaires. Tout cet ensemble, régulé par le droit coutumier, va s’étendre sur l’ensemble du territoire national sans aucune contribution gouvernementale.
L’occupation américaine de 1915 va saper le fondement du monde rural haïtien. D’où probablement les vagues migratoires que va connaître le pays durant cette période. Des centaines de milliers de compatriotes vont s’installer à Cuba, en République dominicaine, pour travailler dans les grandes plantations des entreprises capitalistes nord-américaines.
Voilà, brièvement, une lecture décoloniale de l’histoire des Haïtiens à partir des travaux du sociologue haïtien Jean Casimir. Toutefois, il importe de signaler que c’est impossible de retracer l’itinéraire du peuple souverain d’Haïti dans le cadre d’un article. L’idée c’est d’inviter celleux s’intéressant à l’histoire de ce pays, de prendre en compte le lieu d’énonciation / l’acte de dire dans leur démarche afin d’éviter le piège de la colonialité.
Feguenson Hermogène, journaliste d’Ayibopost
Claudia Alavez, sociologue mexicaine







Comments