Jovenel Moïse a créé un instrument qui peut plier les fournisseurs d’accès à internet aux excès liberticides des gouvernements
En 1787, Thomas Jefferson proclamait son amour pour la presse. « S’il m’était donné de choisir entre un gouvernement sans la presse ou la presse sans gouvernement, je jetterais mon dévolu sur la deuxième option, sans hésiter », pérorait le père fondateur des États-Unis.
Vingt ans après cette ode aux journaux, Thomas Jefferson devenait président. Et au pouvoir, son enthousiasme pour le rôle moteur des journalistes en démocratie battait de l’aile. « Rien de ce qui est vu dans les journaux ces temps-ci ne peut être cru, écrivait-il. La vérité en elle-même devient suspecte quand elle est introduite dans ce véhicule pollué. »
Muhammadu Buhari, président du Nigéria, ne connait probablement pas cette anecdote vieille de plus de deux siècles. Mais comme Thomas Jefferson, il prend désormais place parmi ces chefs d’État caméléons qui, aux abords du pouvoir, s’emparent, font la promotion, affichent leurs adhésions aux instruments de participation massive du public dans les démocraties, pour les répudier quand ces mêmes instruments deviennent des menaces politiques.
Le Nigéria est en proie à une crise sociale plurielle. L’année dernière, des protestataires ont massivement foulé le béton pour exiger le démantèlement d’une unité d’intervention spéciale contre le vol, communément appelé SARS. Cette unité, sorte de BOID local, s’est rendue coupable de multiples atrocités contre des civils. Lors des manifestations catalysées par les réseaux sociaux, spécialement Twitter, des appels à la fin du règne de Muhammadu Buhari ont été lancés, en parallèle aux complaintes pour le démantèlement de SARS.
L’inconfort de Buhari, ancien artisan d’un coup d’État en 1983, contre le rôle fédérateur de Twitter est monté d’un cran quand la structure a supprimé un de ces tweets, menaçant de génocide les sécessionnistes du sud-est de son pays le 4 juin dernier. Illico, l’autoproclamé « démocrate converti » bannit l’utilisation de Twitter, qui l’a beaucoup servi durant sa campagne électorale en 2015.
Une part conséquente des 39 millions d’utilisateurs du réseau dans le pays se sont rués sur des réseaux VPN pour contourner, critiquer et tourner en dérision la décision sur Twitter. Illico, le commissaire du gouvernement les a menacés de poursuites judiciaires.
A priori, le Nigeria, le plus grand pays d’Afrique avec ses 211 millions d’habitants, partage peu avec Haïti. Sauf que, les assauts contre la liberté d’expression instigués par Muhammadu Buhari peuvent potentiellement devenir réalité ici en Haïti. À tout le moins, les conditions matérielles et légales sont réunies. Il suffit d’une volonté politique, d’un manque de vigilance de la société civile et d’une relative indifférence de la communauté internationale.
Digicel détient 70 % des parts de marché de la téléphonie mobile en Haïti. En octobre 2019, un internaute avait demandé sur Twitter au directeur général de la compagnie, Maarten Boute, de garantir publiquement que l’institution ne bloquerait pas l’accès à internet sur demande du gouvernement, en marge des manifestations.
Le CEO de la compagnie rouge a botté en touche. Au lieu d’offrir cette garantie, il a joué la prudence : « Nous n’avons reçu aucune demande dans ce sens, avait déclaré Maarten Boute. Ce serait un très mauvais précédent pour la liberté d’expression et la démocratie si cela devait se produire ». Un très mauvais précédent qui serait techniquement drapé dans un semblant de légalité, au moins depuis l’année dernière.

Partout, la rhétorique de la sécurité nationale se trouve mobilisée pour justifier des atteintes aux libertés individuelles. Pour bloquer Twitter, Muhammadu Buhari parle d’une plateforme « utilisée pour la déstabilisation, la facilitation et l’encouragement d’activités criminelles. » Il s’agirait d’une décision « importante pour maintenir la sécurité du [Nigéria]. »
Le décret portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale d’intelligence (ANI) et celui pour le renforcement de la sécurité publique publiés dans le Moniteur du 26 novembre 2020 peuvent être utilisés comme couverture légale pour ordonner la coupure d’internet ou le blocage de sites spécifiques, qui porteraient atteinte à « la sécurité nationale ».
L’ANI par exemple a pour mission de prévenir et réprimer la criminalité liée aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Elle participe aussi à la surveillance d’individus ou de groupes « susceptibles de recourir à la violence et de porter atteinte à la sécurité nationale et la paix sociale ».
Le décret sur la sécurité définit le terrorisme comme tout acte individuel ou collectif ayant pour but de « troubler l’ordre et la paix publics ». Le document mentionne comme acte répréhensible « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation (…) d’un des actes de terrorisme mentionnés » dans l’instrument législatif. « Selon leur degré de participation », les institutions coupables d’actes de terrorisme risquent la dissolution et des amendes pouvant aller jusqu’à un milliard de gourdes.
Au Nigeria, malgré l’absence d’un cadre légal clair pour l’interdiction des réseaux sociaux, la majeure partie des compagnies de téléphonie mobile et des fournisseurs d’accès à internet ont bloqué Twitter. Peut-on s’attendre à ce que Digicel, Natcom et Access Haïti entrent en résistance contre un gouvernement déterminé à stopper l’usage de Facebook et de Twitter ? Ces compagnies se mettraient-elles du côté de la démocratie et des libertés individuelles, au risque de perdre leur licence ? Rien n’est moins sûr.
Nous avons demandé à Gérard Laborde, responsable légal de Digicel, lors d’une entrevue à AyiboPost en mars dernier, si la compagnie avait déjà collaboré avec l’ANI. Il a répondu par un non catégorique. Cependant, Laborde précise ne pas savoir si l’Agence, déjà en opération selon les mots du président Jovenel Moise, n’est pas passée par la Direction centrale de la Police judiciaire pour obtenir des données confidentielles sur des clients de Digicel.
Pour le moment, deux entités peuvent demander des informations sensibles à la Digicel. Il s’agit des cabinets d’instructions et de la DCPJ. Si ces collaborations s’avèrent nécessaires, notamment pour la conduite d’enquêtes et la résolution de cas de kidnapping, aucune loi ou décret ne vient encadrer l’exercice. Selon Gérard Laborde, des discussions ont été entamées préalablement avec le Conseil national des télécommunications et une adresse e-mail officielle permet le transfert des données. C’est tout.
La Digicel se contente de répondre aux requêtes des juges et de la DCPJ (entre quinze et vingt par jour). La compagnie de télécom n’a aucun pouvoir pour les analyser ou les rejeter. Qui est placé pour empêcher les dérives ? Qui protège les informations confidentielles d’un citoyen lambda, visé par le gouvernement ? Qu’est-ce qui empêche un accès injustifié à des informations sensibles dans un but politique ? Dans quel contexte est-il approprié que Digicel ou Natcom informe le client du transfert vers des autorités de sa localisation ou de son relevé téléphonique ? Et si des individus à la DCPJ s’amusaient à demander les relevés de leurs conjoints ? Qui pourrait les arrêter ?
Les possibilités d’abus sont immenses, alors qu’aucun cadre légal bien élaboré ne vient solidement protéger les libertés individuelles, permettre aux compagnies de rejeter les requêtes injustifiées et encadrer la nécessité pour la justice de faire son travail d’enquête.
Rien ne permet d’affirmer que l’administration en place planifie une coupure d’internet — ou la cessation de services comme Facebook ou Twitter, malgré le poids énorme de ces plateformes dans le débat public. Mais l’absence de dispositions légales pour protéger les citoyens, couplée aux décrets liberticides de l’année dernière laissent ouverte une fenêtre à travers laquelle n’importe quelle administration autoritaire peut s’immiscer. Le prochain gouvernement devrait non seulement rentrer ces dispositions légales controversées, mais aussi s’atteler à offrir un environnement juridique propice à plus de liberté d’expression.

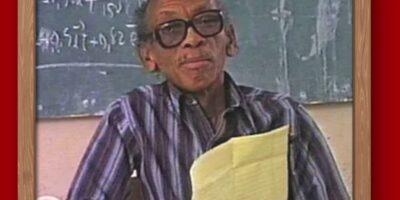





Comments