L’insécurité accentue les différences, la méfiance, les réflexes égoïstes et individualistes. Chacun se barricade dans sa bulle, comme si les problèmes autour n’existaient plus
Avec la sagesse intuitive qui caractérise souvent l’enfance, mon neveu m’a demandé au téléphone « Dans quelle Haïti es-tu ? » Cette question m’a d’abord fait sourire puis a suscité en moi des réflexions sur notre gestion de l’espace et notre perception du territoire national.
Je suis née à Port-au-Prince, j’y ai grandi. Aujourd’hui, je vis à Delmas, commune du département de l’Ouest, entre Port-au-Prince et Pétion-Ville, agglomération gigantesque, immense labyrinthe géographique et social, avec une population estimée à 382,920.
Ecolière, je répondais avec impatience aux camarades qui me disaient « Comment ? Tu n’as pas de pays ? » Comme s’il fallait être d’une province pour avoir un pays. Comme si le centre-ville où mon père nous conduisait chaque veille de Noël n’avait aucune valeur, comme si la chapelle de Saint-Antoine que je voyais depuis la maison n’avait aucune importance, comme si la rue John Brown que je descendais parfois le samedi avec mon frère pour aller en ville n’était rien, que Port-au-Prince n’était qu’un pied-à-terre, une escale scélérate où les souvenirs n’avaient pas leur place, comme si tous ces lieux n’étaient que de simples et tragiques endroits condamnés à subir les conséquences de la violence structurelle, physique, mentale, économique et environnementale qui engloutit le pays.
Port-au-Prince pendant longtemps et spécifiquement depuis l’occupation américaine qui a consacré la concentration des institutions publiques a monopolisé le pouvoir étatique. Le flux migratoire commencé alors continua à un rythme infernal sous la dictature de Duvalier, transformant graduellement la capitale en un monstre.
Un monstre attirant inexorablement un grand nombre de citoyens originaires des diverses provinces. Des nouveaux résidents qui sont venus avec le cœur une sourde aversion contre ce lieu qui semblait incontournable s’ils voulaient avoir une vie meilleure. Un avenir moins lamentable que celui qu’ils auraient eu dans leur village natal. Un peu comme les émigrants qui arrivent en Amérique du Nord avec plus ou moins de méfiance, mais le cœur souvent lourd et les yeux pleins de rêves. La nostalgie les attend au bout du voyage, implacable, cruelle, encore plus forte lorsque les rêves ne s’accomplissent pas et qu’il est quasi impossible de retourner d’où on est parti.
Port-au-Prince pendant longtemps et spécifiquement depuis l’occupation américaine qui a consacré la concentration des institutions publiques a monopolisé le pouvoir étatique.
Port-au-Prince aujourd’hui a gardé son statut de capitale où tout se joue. Les gangs ont participé à la centralisation en y concentrant leurs actions. La population est encerclée. Dans les rares quartiers non encore contrôlés par les gangs, les habitants vivent dans l’anxiété ne sachant quand viendra leur tour. Les murs, les barbelés, les barrages s’élèvent, chaque quartier se protège à sa manière, contre les bandits, mais aussi contre les autres.
L’insécurité accentue les différences, la méfiance, les réflexes égoïstes et individualistes. Chacun se barricade dans sa bulle, comme si les problèmes autour n’existaient plus.
Les commerces tout comme les habitants ont rapidement abandonné le bas de la ville puis le centre pour prendre refuge à Delmas et à Pétion-Ville. Les autorités gouvernementales par incompétence ou indifférence jouent à l’autruche et préfèrent aller s’activer ailleurs pour leurs cérémonies, leurs visites, leurs discours.
Les grandes villes du Nord, du Sud-est et du Sud sont devenues des points de rencontres nationales et internationales et les commerçants absorbent avidement cet afflux important de gourdes et de dollars. Ceux et celles de la diaspora en mesure d’arriver avec moins de risques dans les villes de province organisent ci et là conférences, ateliers, journées d’études, activités culturelles de toutes sortes. Manifestant leur intérêt pour le pays certes, mais participant aussi, sans doute inconsciemment, à la tendance dominante de réduire les problèmes d’insécurité à l’espace de la capitale. Tendance aussi à occulter les problèmes structurels fondamentaux. La normalisation de l’inacceptable s’accomplit. La banalisation de l’intolérable se poursuit.
Tant au niveau des discours que des pratiques. « Les autres villes fonctionnent, c’est à Port-au-Prince que cela ne va pas. » « Nous pouvons aller directement de la Floride au Cap-Haïtien, à Jacmel, aux Cayes. « Bien entendu, si on veut se rendre à Port-au-Prince depuis la Floride, il faut se payer un hélicoptère à 2,000 dollars minimum puis une ou deux nuits d’hôtel au Cap-Haïtien. Un aller-retour peut coûter jusqu’à 10,000 dollars de frais. « Mais tout va bien. Il faut voir comment les activités foisonnent dans certaines provinces. » Madame la Marquise, les structures auraient-elles changé ? Les hôpitaux, les banques, les universités, les établissements scolaires auraient-ils déménagé ?
En outre, le contrôle des routes nationales par les gangs armés affecte tout le pays. Les agriculteurs des provinces ne peuvent pas arriver à la capitale pour écouler leurs produits. De même, certains articles importés de première nécessité atteignent difficilement les provinces. Les cadavres s’accumulent et pas seulement à Port-au-Prince.
À la fin de l’année 2024, en moins dès trois mois, plus de 1,700 personnes ont été tuées sur tout le territoire national. Par ailleurs, l’exode vers l’Amérique du Nord, les Antilles, l’Amérique latine et ailleurs continue. Désespérés, les citoyens haïtiens risquent leurs vies pour échapper à la misère et à la violence.
Mais tout va bien puisque le Cap-Haïtien peut accueillir les avions venant de la Floride, Jacmel peut recevoir un président étranger et Fort-Liberté peut planifier son carnaval, les clubs des Cayes peuvent s’ouvrir aux groupes musicaux sans crainte que leur clientèle se fasse abattre.
Tout va bien, mais les habitants des zones de non-droit dont certains ont un souvenir mitigé du village natal perdent leurs vies sous les balles, les résidents des quartiers populaires s’enfuient par centaines pour échapper aux tirs, les citoyennes sont agressées et violées, les bébés récoltent des balles perdues, les femmes enceintes dans l’impossibilité d’arriver au seul hôpital qui fonctionne meurent ainsi que l’enfant qu’elles portent.
Tout va bien, Haïti ce n’est pas seulement Port-au-Prince, il faut regarder les provinces. Mais pas toutes, surtout ne pas mentionner celles où la terreur s’est installée.
Dans quelle Haïti tu es ? Dans l’Haïti qui a plusieurs pays sur le même territoire, dans l’Haïti des villes insalubres et surpeuplées, dans l’Haïti des régions rurales où le travail de la terre ne rapporte pas grand-chose, dans l’Haïti des quartiers populaires où la misère et la terreur vont main dans la main, dans l’Haïti des villes côtières qui se battent pour survivre, car la mer trop abusée n’est plus généreuse, dans l’Haïti des villes de l’Artibonite où les massacres s’enchaînent, dans l’Haïti des maisons où la nuit tombe trop vite, dans celle des magasins qui doivent fermer car le pouvoir d’achat s’est affaibli, celle des petits marchands qui n’osent plus déambuler au centre-ville, des employés de banque qui vont travailler la peur au ventre, des policiers qui tombent sous les feux des gangs, des enseignants qui mettent leurs vies en danger pour arriver à l’heure, dans l’Haïti des étudiants et des écoliers qui reçoivent des balles en salle de classe.
Dans quelle Haïti es-tu ? Dans l’Haïti des médecins qui continuent sans relâche, souvent sans les outils nécessaires, à sauver des vies, l’Haïti des employés de bureau qui font les gestes qu’il faut pour assurer la continuité des services publics, des parents qui font de leur mieux pour protéger leurs enfants, des artisans, des poètes et des écrivains qui créent, des chercheurs qui continuent leurs réflexions, des militants qui luttent pour un changement réel.
Dans quelle Haïti es-tu ? Dans l’Haïti qui veut se battre contre les inégalités qui perdurent et gangrènent nos 27,750 km². Dans l’Haïti de toutes les citoyennes et de tous les citoyens. De ma ville ou d’ailleurs. Dans l’Haïti qui comprend que les problèmes doivent se résoudre sur tout le territoire ; autrement tout est provisoire.
Dans quelle Haïti es-tu ?
Évelyne Trouillot
13 février 2025
Par Evelyne trouillot
Couverture |Les manifestants à Pétion-Ville ont érigé des pneus en feu le long de la Route de Frères, bloquant l’accès aux véhicules, lors des manifestations contre les nombreuses crises en Haïti. Photo : Murdith Joseph / The Haitian Times – 7 septembre 2022.
► AyiboPost s’engage à diffuser des informations précises. Si vous repérez une faute ou une erreur quelconque, merci de nous en informer à l’adresse suivante : hey@ayibopost.com
Gardez contact avec AyiboPost via :
► Notre canal Telegram : cliquez ici
► Notre Channel WhatsApp : cliquez ici
► Notre Communauté WhatsApp : cliquez ici

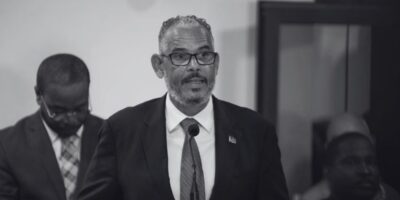



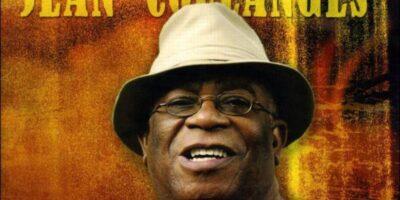

Comments