Pour la sociologue Fania Noël, l’annonce par Macron d’une commission symbolique et inutile sur la dette de l’indépendance est cohérente avec l’idéologie d’un empire qui refuse de disparaître. Ce qui est néanmoins regrettable, dit-elle, c’est de voir cet énième comité Théodule être pris au sérieux par certain-nes du côté Haïtien
Le 17 avril 2025, Emmanuel Macron a finalement accouché non pas d’une souris, mais de l’ombre d’une souris : l’annonce d’une commission franco-haïtienne d’historien·nes chargée d’examiner l’impact de l’indemnité imposée à Haïti en 1825 et de formuler des recommandations. Il faudrait manquer de lucidité sur la politique française et le fonctionnement de l’exécutif pour croire que cette commission soit autre chose qu’un passe-temps pour discuter du sexe des anges.
« Quand je veux enterrer une affaire, je crée une commission », disait Clemenceau. Le général de Gaulle en 1963 à fait du terme comité Théodule, le terme ad-hoc pour désigner les commissions inefficaces, créées pour enterrer des problèmes ou ne pas les résoudre. Sans surprise, lorsque les présidents français souhaitent traiter une question de la plus haute importance, ils évitent la création de toute commission ou comité.
François Mitterrand, par exemple, déclarait : « Je ne veux pas donner l’arme atomique française à un Comité Théodule européen qui n’appuiera pas sur le bouton, sauf si la majorité de ses membres est menacée. » Et effectivement, la France a préservé son autonomie nucléaire.
La commission annoncée le 17 avril est une énième instance Théodule qui rejoint la longue lignée des “commissions machin-choses” auxquelles le gouvernement Macron promettait il y a quelques mois de s’attaquer, les décrivant comme « aussi chers qu’inutiles ».
Autre règle implicite de la vie politique française : plus le nom de la commission est long ou plus l’annonce est solennelle, plus ladite commission sera inutile et n’aura d’impact que sur les comptes bancaires des participant-es, à travers les indemnités, per diem et les frais de bouche. Je le concède, la fête sera belle.
Lire plus : Opinion | Ce que la France doit à Haïti
Du fraternalisme de gauche au cirque Macroniste
François Hollande, fervent défenseur de mesures discursives et symboliques — comme lorsqu’il a fait supprimer le mot « race » de la Constitution en 2018 — avait déclaré l’impossibilité de réparer l’histoire en ce qui concerne la dette d’indépendance.
La différence avec son ancien ministre devenu président, Emmanuel Macron ? Hollande, en bon socialiste, s’inscrit dans ce qu’Aimé Césaire, dans sa lettre de démission du Parti Communiste en 1956, appelait le fraternalisme, une version gauche française du paternalisme colonial.
Macron a toujours assumé son paternalisme, à l’image de sa déclaration sur les pays Africains qui auraient oublié de dire merci. Si le refus d’aborder la dette sur le plan financier et comptable n’est pas étonnant, l’acharnement de la France d’en faire une question morale ou sujet à des réflexions à n’en plus finir, est absurde. La France persiste dans ce que le philosophe Charles Mills décrit comme épistémologie de l’ignorance caractéristique du contrat racial.
La France refuse de reconnaître qu’elle s’est illustrée par son absence de morale et de honte, ainsi que son indigence tout au long de son Histoire; et que la révolution haïtienne constitue pour elle une défaite militaire, idéologique et politique.
Cette révolution a donc remporté tout débat moral ancré dans la liberté, l’égalité et la fraternité. La lettre ouverte publiée dans Le Monde signée par Yanick Lahens, Jean Casimir, Louis-Philippe Dalembert, Roody Edmé, Michele Pierre-Louis et Gary Victor, rappelle à juste titre que « la dette imposée par la France à Haïti a, dès sa naissance, précipité le pays dans la ruine. » Il est dès lors d’autant plus aberrant de voir certaines voix haïtiennes prêtes à considérer la proposition de la France et de Macron comme autre chose qu’un os à ronger jeté par un président impopulaire, en fin de mandat.
Qu’un pays bâti sur la négation de son passé et de son présent colonial — un pays qui incarcère encore des militant·es indépendantistes kanak à 17 000 kilomètres de chez eux en métropole pour casser les élans d’autodétermination — cherche à détourner la question des réparations n’est pas surprenant.
La France refuse de reconnaître qu’elle s’est illustrée par son absence de morale et de honte, ainsi que son indigence tout au long de son Histoire; et que la révolution haïtienne constitue pour elle une défaite militaire, idéologique et politique.
On voit ça et là fleurir les insinuations que, si l’argent était rendu à Haïti il serait mal dépensé à cause de la corruption et la mauvaise gouvernance. Un argument assez cocasse, quand la France affiche son soutien indéfectible au Conseil présidentiel de Transition (CPT).
Le point le plus désolant se situe ailleurs : constater que du côté Haïtiens, cette diversion trouve des echos favorables, renforçant ainsi l’idée que la France, dont le statut de cinquième puissance mondiale repose sur une présence sur cinq continents fondée sur l’esclavage, la colonisation et la FrançAfrique, qu’un « empire qui ne veut pas mourir » (voir Françafrique : un empire qui ne veut pas mourir, sous la direction d’Amzat Boukari, La Découverte, 2019), pourrait encore prétendre déterminer ce qui relèverait du bien pour Haïti.
Quand Macron veut, il fait
Le travail mené par les collectifs haïtiens et afrodescendants sur les réparations vise une revendication claire : obtenir un véritable paiement de la dette de l’indépendance, au-delà des gestes symboliques.
Macron, qui en est à la fin de son dernier mandat, s’est illustré par un mépris constant des processus démocratiques : refus de reconnaître la victoire de la coalition de gauche après la dissolution du parlement et usage répété du 49.3 (un article de la Constitution qui permet au gouvernement de faire passer une loi sans vote) pour imposer une réforme des retraites massivement contestée.
Sa dernière année de mandat a été marquée par un glissement vers un discours sécuritaire et guerrier, et l’accélération de ses appels du pied à l’extrême droite se traduisant par leur présence dans son gouvernement à travers des politiques issues de l’aile droite de la droite, mais aussi dans ses propositions de lois visant à detricoter le système de protection social au profit du capital, racistes et va-t-en-guerre.
Quand Emmanuel Macron souhaite faire passer une réforme, même profondément impopulaire, il parvient toujours à mobiliser les ressources juridiques, techniques et politiques nécessaires. Rompu à l’exercice du pouvoir, il est parfaitement au fait que le seul output de son comité Théodule sera un nouveau volume dans la bibliothèque, déjà très fournie, du palais Bourbon.
La question des réparations est traitée par Macron comme une simple manœuvre tactique, sans jamais s’inscrire dans l’un de ses grands cadres politiques. C’est plutôt une réponse improvisée à une actualité.
Une véritable politique de réparations, quant à elle, se serait intégrée pleinement dans le cadre des politiques publiques. Elle serait votée, débattue, défendue et discutée dans l’hémicycle, dans les médias et à travers les mouvements sociaux. Cela implique forcément des oppositions nationales, des coûts politiques et électoraux à assumer et des négociations sur la scène nationale.
Le faible débat soulevé par la commission Macron en France, vient notamment de la droite et de l’extrême droite, qui s’opposent farouchement à toute allocation pour cette question et qui préfèrent réduire les discussion sur l’esclavage et la colonisation, à des positions anti-’repentences ou sur le rôle positif de la colonisation.
Quand Emmanuel Macron souhaite faire passer une réforme, même profondément impopulaire, il parvient toujours à mobiliser les ressources juridiques, techniques et politiques nécessaires.
Ne pas oublier les centimes
L’heure n’est pas à une commission franco-Haïtienne qui propose des recommandations sur les impacts (ce qui a déjà été fait par de nombreuses organisations), mais à une équipe opérationnelle Banque de France et Banque de la République d’Haïti, capable de structurer un plan de remboursement au minimum de 21 685 135 571.48 USD (sans oublier un seul centime) — le montant le plus couramment avancé, y compris par l’État haïtien. Le New York Times estime que cette somme investie dès l’origine aurait pu générer jusqu’à 116 milliards de revenus pour Haïti.
Les réparations appellent à un plan de paiement clair, avec calendrier, suivi budgétaire, mécanismes de contrôle des versements. Mécanisme que la France connaît très bien, car ses créanciers historiques, comme l’Allemagne, lui versent leurs paiements par virement bancaire.
L’Allemagne a terminé son remboursement en 2010 des réparations liées à la Première Guerre mondiale (1914-1918). En 1849, l’État français versa également des indemnités aux esclavagistes, calculées sur la valeur actuelle des esclaves après la seconde abolition de l’esclavage.
On ne peut être que dubitatif de la déception des universitaires et associations devant ce qui relève de la plus simple et évidente logique quand on assiste à des rappels répétés, à travers les actions du gouvernement français de ce qu’est la politique de la France vis-à-vis des pays noirs et des noirs en France.
Comment peut-on espérer qu’un pays qui a dû abolir l’esclavage deux fois et qui se vante d’être le pays de la liberté, puisse proposer autre chose qu’un écran de fumée, surtout lorsque son territoire qui sétend sur tous les océans, est structuré autour de la relation métropole-colonies (avec les DOM-TOM) ? Cette espérance perpétue l’illusion du sens moral de la France, oubliant les paroles d’Assata Shakur : “Personne dans le monde, personne dans l’histoire, n’a jamais obtenu sa liberté en appelant au sens moral de son oppresseur.”
Les réparations pour Haïti ne viendront que lorsque la France y sera contrainte sous la pression de trois fronts. Le premier est l’État haïtien, qui reste le seul souverain à définir les modalités et les demandes, avec le soutien de sa société civile. Le deuxième est le mouvement social en France, comprenant les associations haïtiennes de France et certains partis de gauche qui se prétendent alignés sur les principes de justice, permettant de maintenir la question sur l’agenda politique national. Maintenir la pression sur l’agenda politique nationale français est indispensable.
En effet, dans le système démocratique néolibéral des décisions qui n’entraînent ni gains ni pertes électorales peuvent facilement se transformer en déclarations sans conséquences. Enfin, bien que les dernières années aient montré les limites de leur pouvoir et l’étendue des passe-droits dont bénéficient les pays occidentaux, les institutions internationales, tant au niveau européen qu’international, doivent faire leur part (ONU, CPI, UNESCO, Cour de Justice Européenne, Union Africaine, CARICOM etc..).
Lire aussi : Vidéo | Qui a profité de la rançon de l’indépendance ?
De la même manière qu’on n’apprend pas au vieux singe à faire la grimace, on n’enseigne pas au pays des Lumières (souvent éteintes) et des Précieuses ridicules, à créer des espaces de production discursive sans finalité d’action politique. La réponse de Macron, loin de représenter un pas vers la justice, marque au contraire un recul stratégique, misant sur le fait que l’illusion de quelques miettes suffira à calmer les exigences, voire même lui valoir de la reconnaissance pour sa « réactivité ».
Les empressements du côté haïtien à participer à cette commission, que la presse française qualifie de “service minimum” , qui n’a ni calendrier, ni aspect contraignant, relèvent des écueils de la politique néolibérale. L’esthétique de l’action politique (faire des commissions, prendre des photos en commission pour LinkedIn) prend le pas sur l’impact de l’action politique dans sa capacité de changer les conditions matérielles d’existence des haitien-ne-s, les rapports de force et le statu quo du continuum colonial.
Ce n’est pas parce que Macron distribue des billets gratuits pour le cirque qu’il faut se précipiter pour y jouer les acrobates. Comme le rappelait Toni Cade Bambara, autrice et intellectuelle Black Feminist : “Not all speed is movement.”
Par : Fania Noël
Docteure en sociologie, essayiste et militante Afroféministe. Installée à New York, elle est professeure adjointe invitée en théorie politique au Pratt Institute et chercheuse au Center for Place, Culture and Politics, CUNY Grad Center. Ses domaines de recherche se situent à l’intersection de la sociologie politique, des Black Studies, des études de genre et des études critiques des médias. Son dernier ouvrage 10 questions sur les Féminismes Noirs a été publié en 2024 chez Libertalia.
Couverture | Photo du président français Emmanuel Macron. ( Source : France 24 ) Une femme nettoie la rue à côté d’une barricade en flammes érigée par des manifestants lors d’une protestation contre l’insécurité à Port-au-Prince, Haïti, le mercredi 2 avril 2025. ( Source : WCBD NEWS 2 /Odelyn Joseph) Collage : Florentz Charles pour AyiboPost
► AyiboPost s’engage à diffuser des informations précises. Si vous repérez une faute ou une erreur quelconque, merci de nous en informer à l’adresse suivante : hey@ayibopost.com
Gardez contact avec AyiboPost via :
► Notre canal Telegram : cliquez ici
► Notre Channel WhatsApp : cliquez ici
► Notre Communauté WhatsApp : cliquez ici





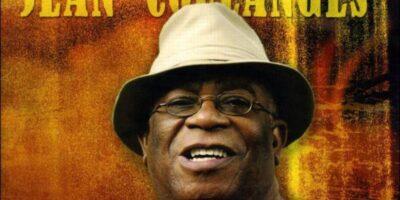

Comments